Vive la cotisation sociale !
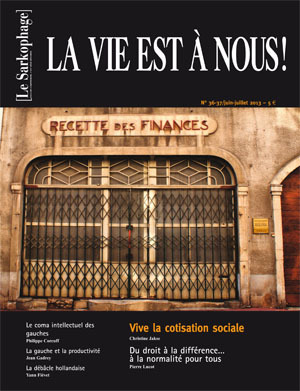
Dès l’instant où les gouvernements successifs ont décidé du gel progressif des taux de cotisation sociale, entre 1979 et le milieu des années 90, les régressions sont allées bon train pour les salariés : droits d’accès à la sécurité sociale durcis et réduits, niveau des prestations affaiblis, durée de versement limitée.
Ces décisions ont été prises par la droite et la gauche dominante au nom de l’emploi, de la dette et de la compétitivité, en brandissant systématiquement l’argument de l’équité. C’est ainsi le chantage à l’emploi qui a justifié les exonérations de cotisation sociale, sans effet probant. C’est la dette qui a justifié l’avancement d’une année de la réforme des retraites en 2012 ou encore la journée de carence pour les fonctionnaires. C’est la compétitivité du Rapport Gallois qui justifie la baisse de 20 milliards sur trois ans des cotisations sociales pour les salaires compris entre une fois et 2,5 fois le Smic. Entre temps, les dividendes se sont multipliés par trois. Et l’équité permet depuis 30 ans de moraliser les décisions de recul des droits individuels, par exemple celles d’allongement de la durée de cotisation requise pour la retraite à taux plein ou d’indemnisation du chômeur : en résumé, « j’ai droit en proportion de ce que je cotise ». Pourtant, nul n’ait besoin de « cotiser » pour avoir droit, comme le prouvent les ayants‑droit du régime de santé ou les conjoints survivants pour la pension de réversion. Et personne ne met de côté sa cotisation pour sa retraite, son licenciement, sa maladie : le système étant en répartition, la cotisation collectée est immédiatement transformée en prestations. Il suffit d’un volume de cotisation suffisant pour couvrir les besoins.
Une impasse à la gauche de la gauche
Quant aux opposants aux réformes – la gauche de la gauche –, ils mobilisent trois axes revendicatifs et opèrent une distinction, qui les conduisent dans l’impasse. D’abord, ils proposent une modulation des taux de cotisation sociale selon que l’employeur recrute en emploi pérenne et qualifié, ou non. Ce faisant, ils font le jeu de l’emploi contre la cotisation, reprenant finalement sous une autre forme l’argument des « exonérations de charges ». Ensuite, ils proposent une taxe sur les dividendes et un élargissement de l’assiette de calcul de la cotisation à l’intéressement ou à la participation (en plus du salaire brut) : que font‑ils d’autre sinon appeler à l’aide leur ennemi, le capital, le confortant en même temps dans sa nécessité indépassable ? Enfin, en s’appuyant sur l’argument de la solidarité, ils déplacent l’enjeu hors de la lutte « travail/capital », alors même que les réformateurs ne s’y trompent pas quand ils lancent des cris d’orfraie face aux « coûts du travail » ou aux « charges » insupportables !
L’autre difficulté tient dans la distinction opérée par les opposants aux réformes (et les réformateurs), entre « risques universels » (santé, famille) et « risques professionnels » (retraite, chômage). Elle est dangereuse. Car, naturaliser l’idée qu’il y aurait des risques universels conforte les partisans de la fiscalisation de la Sécu (la CSG) comme en Grande Bretagne par exemple : or, l’impôt ne fait que corriger les inégalités sans remettre en cause le système capitaliste. Parallèlement, naturaliser l’idée qu’il y aurait des risques professionnels aboutit à rejeter hors de la Sécu ceux « qui n’ont pas cotisé » parce qu’ils n’ont pas travaillé dans l’emploi. C’est créer des pauvres à qui les riches font l’aumône de minima sociaux financés par leur impôt ; pourtant, on l’a dit, personne ne cotise. C’est aussi intérioriser l’idée qu’il n’y a de salaire que dans l’emploi.
Une alternative stimulante
Or, précisément la cotisation sociale prouve qu’il peut y avoir salaire hors du marché du travail. Mieux, elle nous laisse entrevoir une alternative stimulante : l’émancipation du marché du travail et du capital. Voyons en quoi.
D’abord, précisons que toute hausse de la cotisation sociale, loin d’être une amputation du salaire direct ou même du profit, augmente d’autant la richesse nationale (le produit intérieur brut, PIB). Ce fut le cas par exemple avec le remplacement des nonnes, bénévoles, par des infirmières, salariées : leur salaire est venu accroître d’autant le PIB. Ainsi, la croissance du PIB due à la cotisation sociale est‑elle vertueuse puisqu’elle reconnaît une nouvelle valeur qui sort de la sphère capitaliste. Et cette valeur créée est du salaire.
Car la cotisation sociale relève bien du salaire : c’est celui des soignants et des malades (assurance santé), des retraités (régimes de retraite), des parents (allocations familiales), des chômeurs (régime Unedic d’indemnisation des chômeurs). Quand la cotisation recule, c’est donc leur salaire qui recule. Et ce salaire n’est pas un revenu banal. Car pour assurer sa métamorphose en salaire (en une journée à la caisse nationale des URSSAF), la cotisation sociale revêt les mêmes habits que son frère, le salaire direct : comme lui, elle est un barème – les taux de cotisation sociale, le taux de remplacement du salaire de référence, les barèmes de remboursement des médicaments, etc. –, administré.
En effet, la cotisation sociale, comme le salaire direct, relèvent du politique, non pas de l’économique, puisque les décisions sont prises dans le cadre d’un rapport de forces entre les organisations syndicales et patronales, avec un encadrement de l’Etat et non pas par confrontation d’une offre et d’une demande dans un marché (du travail) : la cotisation sociale est fixée par voie règlementaire ou négociée (Unédic) et est gérée au sein des caisses de sécurité sociale ; le salaire direct est fixé dans le cadre des conventions collectives.
Cotisation et qualification
Enfin, la cotisation sociale est adossée à la qualification professionnelle. C’est celle du médecin via son diplôme, mais aussi celle du malade (indemnité journalière), du chômeur (indemnité chômage), du retraité (pension) : le taux de remplacement du salaire perdu, la leur transmet. En effet, la grille salariale des conventions collectives associe salaire et qualification professionnelle. Or, la qualification professionnelle, comme la cotisation sociale, a été une avancée considérable pour le salarié. Car, contrairement au revenu à la tâche ou à la pièce jusqu’au début du 20ème siècle ou encore à la prime de résultat d’aujourd’hui, elle a permis d’éloigner le salaire de l’aléa de la production : je ne suis pas payé‑e selon ce que je produis à l’instant t, mais selon la qualification professionnelle de mon poste. Elle limite donc les risques de me transformer en ressource humaine, en force de travail, en marchandise corvéable et payable au prix du marché. Mais, la qualification professionnelle reste fragile dans le secteur privé dès lors qu’il y a perte d’emploi, car elle est adossée à un poste et non à la personne du salarié : le chômeur peut la perdre, plus encore depuis l’ « offre raisonnable d’emploi » qui autorise la déqualification au bout de la troisième offre d’emploi refusée. Cette difficulté est contournée dans la fonction publique, où le fonctionnaire est titulaire de sa qualification à travers son grade, qu’il (trans)porte où qu’il aille, sans risque de le perdre et avec l’assurance d’une progression continue.
Nous voici donc en présence de deux institutions puissantes : la cotisation sociale qui nous prouve que l’on peut percevoir un salaire hors du marché du travail aliénant – ce qui ne veut pas dire hors du travail – et la qualification personnelle qui nous prouve qu’on peut être porteur d’un potentiel de production sans risque de déclassement.
On le pressent, la cotisation sociale et la qualification personnelle nous fraient un chemin vers un impensable pourtant bien réel : percevoir un salaire hors du marché du travail, tout en nous reconnaissant une capacité à produire, à travers une qualification personnelle. Il suffirait de généraliser la cotisation à l’ensemble des salariés et la qualification personnelle à tous. Allons plus loin encore : pourquoi ne pas étendre le principe de la cotisation sociale aux grands investissements, dans une caisse économique où les choix seraient pris démocratiquement ? Fini les investisseurs, le crédit, les actionnaires. L’investissement est, aujourd’hui, de l’ordre de 400 milliards d’euros, un peu moins que le montant de la cotisation sociale (450 milliards d’euros). Toute la richesse créée pourra alors être répartie en trois caisses : celle de la cotisation sociale actuelle, celle des salaires, celle des investissements, chacune gérée et maîtrisée démocratiquement.
Nous avons alors tous les ingrédients pour répondre à nos besoins, en maîtrisant la quantité, les moyens, le temps, la façon de faire, dans le respect de l’environnement, bref l’ensemble des choix qu’on laisse aujourd’hui aux mains du capital et des réformateurs. A nous le PIB !









