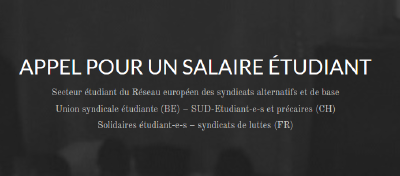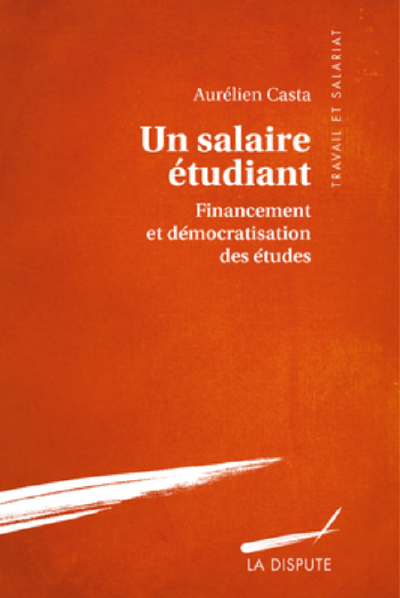Un salaire étudiant pour « refuser que les études supérieures soient fermées à certains groupes sociaux »

Les étudiants étrangers non-européens devront désormais débourser plusieurs milliers d’euros pour étudier en France. C’est la première étape d’une hausse généralisée pour tous les étudiants, comme le montre l’expérience britannique. La revendication d’un accès gratuit à l’université, voire d’un salaire étudiant, reste d’actualité pour contrer ces inégalités. Entretien avec le sociologue Aurélien Casta.
Interview originale publiée sur le site Basta le 15/09/2020
Basta ! : Cette rentrée universitaire inaugure les nouveau frais d’inscription décuplés pour les étudiants étrangers non-européens - 2770 pour la licence, 3770 euros en master, contre 170 euros et 243 euros pour les étudiants français et de l’Union européenne. Comment l’idée d’augmenter les frais d’inscription a-t-elle réussi à s’imposer ?
Aurélien Casta: Il y avait déjà le projet de loi Devaquet dans les années 1980 [le projet de loi de 1986 d’Alain Devaquet, ministre de l’Enseignement supérieur du gouvernement de Jacques Chirac, voulait introduire la sélection à l’entrée des universités et leur donner la possibilité de fixer elles-mêmes leurs droits d’inscriptions, ndlr]. Il a été abandonné suite à un mouvement social massif. Ensuite, jusqu’à la fin des années 1990, seuls des acteurs classés à droite ou à l’extrême droite continuaient à défendre une hausse des droits d’inscriptions. Puis, les directeurs d’établissements ont repris l’idée, qu’il s’agisse de présidents d’universités publiques ou de directeurs de grandes écoles publiques et privées. La Conférence des grandes écoles et celle des présidents d’universités publiques ont commencé à travailler sur la hausse des frais d’inscription. À la fin des années 2000, des groupes de réflexion de droite comme de gauche, l’Institut Montaigne, Terra Nova, et des groupes patronaux comme l’Institut de l’entreprise, ont appuyé cette demande.
Les présidents d’universités ont-ils rallié l’idée d’une hausse des inscriptions parce que les financements publics des universités se réduisaient ?
Ce qui est certain, c’est qu’à partir du milieu des années 1990, des rapports d’experts commandés par les ministères annoncent que les subventions publiques aux établissements n’allaient pas pouvoir suivre la hausse des effectifs étudiants, et qu’il y aurait un problème de financement. C’est notamment ce que dit le rapport Laurent dès 1994 (du nom de Daniel Laurent, alors président de l’université de Marne-la-Vallée : "Universités, relever les défis du nombre" [2]). Ces rapports ont été communiqués aux présidents des universités pour les acclimater à la situation.
Les universités britanniques n’ont pas toujours été payantes et chères comme aujourd’hui. Comment cela s’est-il passé au Royaume-Uni ? La France suit-elle le même processus ?
Après-guerre, la Grande-Bretagne a démocratisé l’enseignement supérieur. Cela a reposé jusqu’en 1997 sur un système qui garantissaient à la fois la gratuité des études pour les étudiants à temps plein, et le versement d’une prestation aux étudiants. Celle-ci représentait jusqu’à deux fois l’équivalent des bourses françaises sur critères sociaux, soit 6000 à 7000 euros par an pour les frais de vie courante pour les personnes issues des milieux les moins favorisés.
La première mesure décisive a été prise sous le gouvernement de Margaret Thatcher en 1982. Il s’agissait d’une déréglementation des frais d’inscription demandés au étudiants étrangers non-européens. Ce qui résonne évidemment avec ce qui se passe en France aujourd’hui. De cette décision résulta une hausse considérable des frais pour cette catégorie d’étudiants. Ensuite, le gouvernement Thatcher n’a pas réussi à aller plus loin. Il n’a pas pu imposer la même mesure aux ressortissants britanniques. La relance du projet a lieu à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Ce sont là-aussi les présidents d’universités qui ont pris position publiquement pour la hausse des frais d’inscriptions et la mise en place en parallèle d’un système de prêts. Ils ont été suivis par le parti travailliste.
Quels étaient les arguments des travaillistes, la gauche britannique, pour soutenir cela ?
Le principal argument qui a pu susciter l’adhésion venait du débat autour de la justice sociale. Au début des années 1990, la nouvelle génération de travaillistes, notamment Tony Blair et Gordon Brown, affirment que le système de gratuité est injuste, car ce sont les personnes issues des milieux favorisés qui vont à l’université et qui bénéficient donc de cette gratuité. Celle-ci est financée par la collectivité, y compris les ménages populaires. Selon eux, il était temps de remettre en cause cette politique. Cet argument fait cependant l’impasse sur un fait incontestable : pendant les années 1970 et 1980, les ménages populaires, et les femmes, ont eu de plus en plus accès aux universités. Les travaillistes ont au contraire affirmé que l’enseignement supérieur ne serait jamais ouvert à toutes et à tous, et qu’en conséquence, il faut le faire payer à ceux qui y ont accès car ils en ont les moyens. Voilà le tournant idéologique.
Y-a-t-il eu des résistances de la part des étudiants alors, ou cela est-il venu plus tard, quand les frais d’inscription ont atteint des niveaux extrêmement élevés en 2010 avec un fort mouvement étudiant ?
La protestation a été systématique. Aujourd’hui, une année de licence coûte environ 10 000 euros en Grande Bretagne, mais cela s’est fait progressivement, en trois réformes. Celles de 1997 et 2004 ont été adoptées sous des gouvernements travaillistes, celle de 2010 avec au pouvoir les conservateurs et les libéraux. À chaque fois, il y a eu un mouvement étudiant très important, qui n’a pas été facilité en 1997 et 2004 par le syndicat étudiant unique et historique, le NUS [National Union of Students], qui a tendance à jouer le jeu de la négociation avec les travaillistes. Les mobilisations ont été plus fortes et violentes en 2010.
Vous expliquez aussi dans votre livre, Un salaire étudiant, qu’en Grande-Bretagne, l’augmentation des frais d’inscription s’est accompagnée de la mise en place de prêts étudiants pris en charge par une agence d’État. Ne s’agit-il donc pas d’une certaine manière d’un simple biais comptable : l’État ne finance plus directement les universités, mais indirectement via des prêts, qui n’apparaissent pas de prime abord comme une dépense publique ?
Le dispositif est en effet ambigu. En réalité, le système de prêts étudiants mobilise des sommes extrêmement élevées, tout à fait comparables aux sommes nécessaires pour l’ancien système, qui garantissait la gratuité. L’endettement des étudiants britanniques n’est pas assuré par les banques commerciales, pour qui le risque est trop important. Donc, c’est l’État qui l’assume. Les prêts courent sur 30 ans. Sauf que beaucoup d’organismes publient des études estimant que les prêts ne seront remboursés, au grand maximum, qu’à hauteur de la moitié des sommes engagées. Le reste sera définitivement assumé par les caisses de l’État.
Quel effet a eu l’augmentation des frais d’inscription sur l’accès des jeunes des classes populaires à l’enseignement supérieur au Royaume-Uni ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une série d’études converge pour dire qu’il n’y a pas de baisse drastique des inscriptions des jeunes des milieux populaires dans l’enseignement supérieur. Des inégalités se sont cependant développées sur le départ du foyer parental. Les départs se font plus tard. Les étudiants des ménages populaires limitent aussi leur choix d’établissements aux plus proches, même pour ceux qui pourraient avoir accès à des établissements plus prestigieux mais éloignés. Un autre effet constaté concerne l’emploi pendant les études : les étudiants des ménages populaires travaillent en plus de leurs études, et consacrent donc moins de temps à celles-ci. Les étudiants les moins favorisés ont aussi tendance depuis ces réformes à souscrire des prêts complémentaires auprès de banques commerciales, en plus de l’endettement auprès de l’organisme d’État. Or, ces prêts commerciaux sont beaucoup plus coûteux.
En France, alors que la question de l’augmentation des frais d’inscriptions est relancée par ce gouvernement, les organisations étudiantes défendent toujours l’accès gratuit à l’enseignement supérieur. Plusieurs portent même l’idée d’un salaire étudiant : payer les étudiants pour se former. Cette revendication est-elle ancienne ?
Elle date de l’après-guerre. C’est l’Unef, la principale organisation étudiante à l’époque, qui porte ce projet, avec le soutien de parlementaires. Les questions de l’accès aux études et de leur démocratisation font partie des revendications de l’Unef dès sa création. En 1948, le syndicat étudiant adopte sa charte de Grenoble, qui énonce des principes sur l’enseignement supérieur mais qui vont aussi au-delà. On a alors des étudiants marqués par la guerre, par la présence de l’occupant nazi et par l’action de la Résistance dans laquelle de nombreux étudiants se sont engagés. Dans la charte de Grenoble, l’Unef parle de révolution économique et sociale. L’organisation veut participer à un changement, économique et social, général et profond.
Quels sont alors leurs arguments pour un salaire étudiant ?
L’Unef défend d’abord un grand principe : que les étudiantes et les étudiants sont des travailleurs, produisent des choses utiles à la collectivité, et cela même pendant leur formation. L’organisation mène un combat idéologique pour faire des étudiants des acteurs économiques légitimes : ce n’est pas parce que nous sommes en formation que nous ne sommes pas des acteurs économiques à part entière. À ce titre, notre travail doit être valorisé économiquement et financièrement, et il est nécessaire de nous verser un salaire.
Pourquoi la mesure n’a finalement pas été adoptée ?
On est passé tout près de l’adoption à l’Assemblée nationale en 1951. Les communistes, les chrétiens-démocrates, dans une moindre mesure les socialistes, ont repris ce projet à leur compte et formalisé une proposition de loi. Les parlementaires l’ont défendue en séance plénière. Mais après l’adoption d’un premier article, les ministres socialistes de l’Éducation nationale et des Comptes publics ont fait obstacle au projet, sur la base d’arguments techniques.
Un principe de rémunération pendant les études a pourtant été mis en place pour les étudiants de certaines grandes écoles, comme l’École normale supérieure, l’ENA, ou celle de la magistrature, avec des rémunérations pouvant avoisiner 1600 euros bruts par mois, en échange d’un engagement de service…
Oui, mais cela n’est pas lié à ce projet de salaire étudiant. Dès 1948, certains étudiants des écoles d’État prestigieuses bénéficient d’un système de pré-traitement. Le projet de l’Unef était d’une autre ampleur, le salaire était universel, il concernait toutes les étudiantes et tous les étudiants. C’est un projet de démocratisation. Ce n’est pas lié à la démarche des écoles prestigieuses d’État qui est de sélectionner une toute petite minorité de personnes.
Les organisations étudiantes ont-elles ensuite continué à porter cette revendication ?
Dans le mouvement étudiant français, il y a toujours eu des syndicats et des groupes qui ont défendu la mesure. Aujourd’hui, Solidaires étudiants continue à défendre cela, les étudiantes et étudiants communistes aussi, et des minorités au sein de l’Unef.
Cela peut-il prendre aujourd’hui la forme d’une allocation d’autonomie ?
C’est ce qui est devenu officiellement le salaire étudiant à l’Unef. Mais quand on regarde le fond de cette mesure d’allocation d’autonomie, l’idée s’est quand même considérablement affadie. La référence au travail des étudiant.es, au reste des travailleuses et travailleurs, est bien moins évidente quand on lit les argumentaires actuels. Cela a perdu de sa force de frappe révolutionnaire. L’allocation d’autonomie est de moins en moins défendue pour subvertir l’ordre économique et social dominant. Le terme cache aussi des débats internes à l’Unef.
En quoi le projet de salaire étudiant est-il révolutionnaire à vos yeux ?
Il l’est à plusieurs niveaux. Ce projet est lié à une démocratisation générale des études supérieures. Il porte toujours en lui la bataille pour l’accès aux études des ménages populaires, des femmes et des personnes étrangères. Défendre que l’accès aux études supérieures doit être total, refuser que les études soient fermées à certains groupes sociaux, c’est révolutionnaire. De façon plus générale, au niveau économique et social, c’est révolutionnaire de questionner ce qu’est le travail.
Avec le salaire étudiant, une bataille est menée sur cet aspect : "Si aujourd’hui, en tant qu’étudiant, on est pauvre et dans la précarité, c’est parce qu’on ne nous reconnaît pas l’utilité présente de ce qu’on fait. On nous refuse l’utilité, on nous refuse le travail, et donc on nous refuse le salaire". Avec le salaire étudiant comme programme et comme stratégie politique, on souhaite collectivement combattre ce déni qui nous est imposé et dont on souffre au quotidien. Il ne s’agit pas seulement d’idéologie. Ce déni se traduit par une absence très concrète de rémunération, avec des enjeux forts, notamment sur les stages, qui se sont banalisés et pour lesquels on est loin d’avoir droit au salaire.
Ce sont deux modèles de la valeur des études qui s’opposent ? Celui des études gratuites, considérées comme du travail, contre celui, capitaliste, des études payantes, considérées comme un investissement financé par des prêts ?
Cela va au-delà. Nous faisons face à plusieurs oppressions. Le capitalisme en fait partie, le patriarcat et le racisme aussi. Ces dernières oppressions jouent aussi énormément dans le refus de salaire fait aux étudiantes et étudiants. Le projet et la stratégie du salaire étudiant ont été repris au Québec ces dernières années, avec les Comités unitaires sur le travail étudiant, les Cute. Leurs membres mettent en avant que le refus de salaire fait aux étudiant.es s’impose davantage aux femmes qu’aux hommes, de la même manière qu’il s’impose plus aux classes populaires et aux personnes issues de l’immigration. Par exemple, au Québec, les stages sont systématiquement rémunérés dans les filières d’études où les hommes sont majoritaires et pas dans les filières d’études en majorité féminines, comme le travail social ou l’éducation [3]
Le diagnostic mériterait d’être mené en France. Nous avons ici des études rémunérées, comme dans les grandes écoles prestigieuses d’État. Ces filières ne sont-elles pas l’apanage de certaines couches sociales ? N’accueillent-elles pas plus des hommes, et n’excluent-elles pas davantage les personnes qui sont issues de l’immigration, les personnes étrangères ? À chaque fois que le salaire étudiant est défendu dans une lutte, la discussion dépasse largement le cadre de l’université. Des militantes et des militants se saisissent de la question du salaire étudiant pour politiser collectivement les enjeux du travail et de sa définition.
Recueilli par Rachel Knaebel.