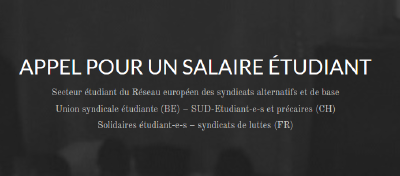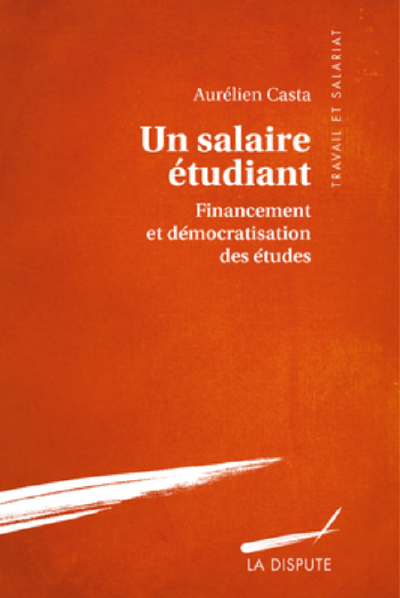En 1951, l’Assemblée faillit adopter le salaire étudiant
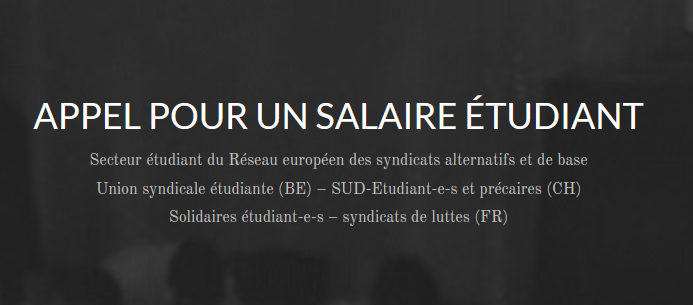
Paru dans le dossier du monde diplomatiques de janvier 2020 : Retraites, la réfome de trop
Comment remédier à la misère étudiante ? Après la guerre, des forces syndicales et associatives avaient fait émerger une idée aujourd’hui oubliée : salarier ces « jeunes travailleurs intellectuels ».
Le 8 novembre dernier, Anas, étudiant en science politique à Lyon, s’est immolé par le feu dans l’enceinte du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous). Il est depuis plongé dans le coma. En cohérence avec la communication gouvernementale, la couverture médiatique de son geste et des manifestations qui l’ont suivi s’est beaucoup attardée sur la chute d’une grille du ministère de l’enseignement supérieur, et surtout sur la « précarité étudiante », un phénomène en général illustré par le faible nombre des bourses, la part de ceux qui occupent un emploi en parallèle de leur cursus (46 % en 2016) ou le taux de pauvreté de cette population (21,9 % des effectifs en 2015). Les constats et les solutions politiques formulés par Anas dans la lettre qu’il a laissée, et par son syndicat, Solidaires étudiant-e-s, ont été moins discutés.
On a ainsi peu parlé de sa revendication d’un salaire étudiant. La mesure, associée à la gratuité de l’enseignement supérieur, consiste à verser à chaque étudiant une rémunération égale à un barème salarial, par exemple le salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic, soit près de 1 200 euros net par mois). Elle traduit un projet politique des plus ambitieux, qui excède la lutte contre la précarité, puisqu’il s’agit d’œuvrer à un changement de société radical en menant une bataille culturelle autour de la définition du travail.
En France, les premiers projets en faveur du salaire étudiant ont été exposés dans le cadre de la Résistance, à partir de 1943, par des syndicats de salariés, des associations de jeunesse et les deux syndicats étudiants existant à l’époque, l’Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l’Union des grandes écoles (UGE). L’idée fut reprise en 1945 par une poignée de syndiqués à l’UNEF. Compte tenu des difficultés matérielles (nourriture rationnée, logements détruits par la guerre), l’image de l’« étudiant pauvre » est alors mobilisée, tandis que les appels à la charité se multiplient. Le Figaro, dans son édition du 8 avril 1948, demande par exemple à ses lecteurs de « mettre à la table familiale un couvert de plus, une fois ou deux par semaine, pour un étudiant en difficulté (1) ».
Adoptée lors du congrès de l’UNEF de 1946, la charte de Grenoble mobilise un tout autre registre. Évoquant la nécessité d’une « révolution économique et sociale au service de l’Homme », elle consacre une formule énoncée dès son premier article : « L’étudiant est un jeune travailleur intellectuel » — notamment du fait de sa contribution à l’« effort unanime de reconstruction ». Votée de justesse, elle a servi de référence lorsque l’UNEF a empêché un doublement des frais d’inscription universitaires, en 1947, ou quand elle a obtenu l’extension du régime de la Sécurité sociale aux étudiants, en 1948.
La charte de Grenoble a connu son heure de gloire en mai 1951. Elle fut alors saluée en séance plénière à l’Assemblée nationale par des députés communistes et chrétiens-démocrates qui avaient décidé de faire adopter l’idée de salaire défendue par l’UNEF. Dans son exposé, le rapporteur du projet, le chrétien-démocrate Raymond Cayol, défendit la mesure au nom « de la valeur personnelle de l’étudiant, de sa qualité présente [et] du travail qu’il poursuit ». Outre une intégration des écoles privées dans l’université publique et une réforme de l’architecture globale des formations, inspirées du plan Langevin-Wallon de 1947, la proposition parlementaire prévoyait le versement à chaque élève d’une rémunération alignée sur le salaire de base utilisé pour calculer les prestations familiales.
La proposition est finalement reportée sine die. Elle a en effet suscité l’hostilité de ministres socialistes influents. Ils concentrent leurs critiques sur l’organisme responsable de la distribution de la rémunération et de la mise en place des réformes éducatives auxquelles elle est liée. « Il n’apparaît pas que tous les ministères intéressés (…) aient été appelés à son conseil d’administration (…) ; sa composition paritaire risque de mettre en minorité les représentants de l’État, alors qu’il s’agit de gérer des sommes d’une si grande importance qu’il est difficile de les chiffrer », objecta ainsi le ministre de l’éducation Pierre-Olivier Lapie.
Depuis cet échec, la revendication a quelque peu disparu du paysage politique français. Avec la théorie du capital humain, qui a gagné en influence depuis vingt ans, les étudiants sont plutôt pensés comme des investisseurs : ils tentent de maximiser leurs revenus futurs, et il paraît dès lors inenvisageable de les rémunérer. Pourtant, les idées de la charte de Grenoble ont continué d’essaimer, y compris hors de France, où des organisations se sont ponctuellement réapproprié ce projet. Ce fut récemment le cas au Québec, à l’occasion d’une grève des stages, lancée entre 2017 et 2019 par des comités unitaires sur le travail étudiant (CUTE).
Le mouvement a débuté quelques années après la contestation du « printemps érable », qui avait (temporairement) mis en échec un projet de hausse spectaculaire des frais d’inscription (2). Dans la ligne de mire des CUTE : ce travail fréquemment imposé et prenant représenté par les stages, qui durent plusieurs mois et sont effectués hors du lieu d’études. Une preuve, selon les militants, que le travail étudiant payé et reconnu existe déjà mais uniquement dans les formations où les femmes sont minoritaires (ingénierie, gestion, informatique, médecine) : dans les filières où elles sont majoritaires (travail social, éducation, soins infirmiers), les stages pas ou mal rémunérés prévalent (3). Cette stratégie a conduit des dizaines de milliers de personnes à revendiquer un salaire pour leurs stages et leurs études, et à participer aux grèves, qui ont culminé lors de l’hiver 2018. S’il est trop tôt pour en tirer un bilan, le mouvement peut d’ores et déjà se targuer d’avoir obtenu, au printemps 2019, des bourses de stage de 600 à 3 000 euros pour des formations féminisées qui jusque-là n’étaient pas rémunérées.
Moins de stages rémunérés pour les enfants d’ouvriers et les femmes
En France, une grève des stages menée au nom du salaire étudiant pourrait s’appuyer sur un contexte similaire. Les effectifs de l’enseignement supérieur sont devenus très importants (près de 2,7 millions d’inscrits en 2018, dont 80 % dans le public), plus féminins et davantage issus des classes populaires (4). Le nombre de stages a par ailleurs fortement augmenté dans l’université publique, sous la pression de la professionnalisation des études : en 2018, 40 % des inscrits en troisième année de licence et 64 % des élèves de deuxième année de master en avaient effectué un.
Comme au Québec, les inégalités entre filières sont fortes. Les stagiaires venus des écoles de commerce (qui n’accueillent que 12,8 % d’enfants d’ouvriers et d’employés, contre 28,4 % pour l’ensemble des formations du supérieur (5)) ou d’ingénieurs (où les femmes ne représentent que 30,3 % des effectifs) reçoivent souvent des rémunérations comprises entre 600 et 1 000 euros (6). La situation est bien différente dans les formations universitaires généralistes où les femmes (56,2 % des effectifs) et les classes populaires (29,7 %) sont plus présentes, et où les stages d’une durée supérieure à deux mois, et donc indemnisés, sont moins fréquents. Seuls 22 % des stagiaires inscrits en master ont reçu une gratification supérieure à 600 euros par mois (contre plus de 50 % dans les écoles d’ingénieurs), la proportion tombant même à 4 % en licence. Une enquête montre en outre des différences disciplinaires en master, avec des « sciences exactes » plus masculines, moins populaires et plus favorisées lors des stages que les autres formations généralistes (lettres, sciences humaines et sociales, économie, droit) (7).
S’agissant des stages comme d’autres périodes d’études rémunérées (apprentissage, formation continue, études de santé, doctorat, formations d’écoles d’État prestigieuses, etc.), la perspective d’un salaire étudiant permet de lutter non seulement contre la précarité, mais aussi contre les inégalités qui la nourrissent, dans l’enseignement supérieur et au-dehors.
Aurélien Casta
Sociologue et économiste, chercheur associé au Clersé (université de Lille) et à l’Idhes (université Paris Nanterre), auteur d’Un salaire étudiant. Financement et démocratisation des études, La Dispute, Paris, 2017.
(1) Cité par Didier Fischer, dans Robi Morder (sous la dir. de), Naissance d’un syndicalisme étudiant. 1946 : La charte de Grenoble, Syllepse, Paris, 2006.
(2) Lire Pascale Dufour, « Ténacité des étudiants québécois », Le Monde diplomatique, juin 2012.
(3) Cf. par exemple Amélie Poirier et Camille Tremblay-Fournier, « La grève des stages est une grève des femmes », Françoise Stéréo, no 9, Québec, 23 mai 2017.
(4) « Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche », ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (Menesr) - direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), Paris, 2019. Toutes les données qui suivent proviennent de ce document et de ses éditions annuelles précédentes.
(5) Et non pas pour l’ensemble des formations secondaires comme indiqué par erreur dans l’édition imprimée.
(6) Cf. par exemple Étienne Gless, « Stages : les formations qui “paient” le mieux », L’Étudiant, Paris, 8 novembre 2019. Constat déjà établi par Jean-François Giret et Sabina Issehnane, « L’effet de la qualité des stages sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur », Formation emploi, no 117, Marseille, janvier-mars 2012.
(7) Jean-François Giret et Sabina Issehnane, ibid.