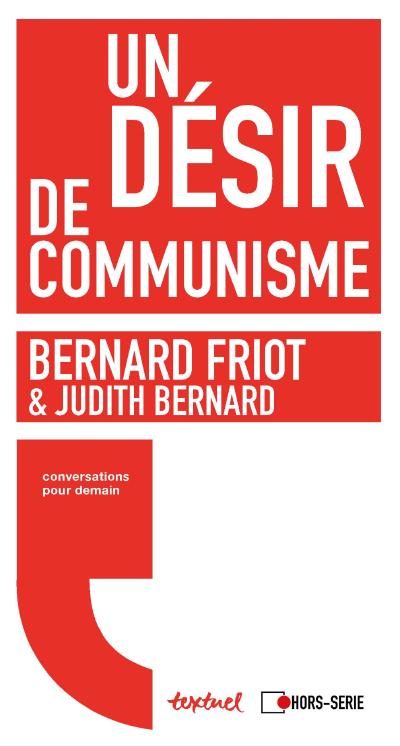Entretien pour le magazine "Frustration"

On a tous quelque chose en nous de communiste. Et même que ce quelque chose réside dans des institutions que nous connaissons très bien, dont la plupart du temps nous nous félicitons de leur existence. Lesquelles ? Le statut de la fonction publique et le régime général de la sécurité sociale, bien sûr ! C’est ce que nous explique de manière évidente non sans une certaine pugnacité l’économiste et sociologue du travail Bernard Friot, que nous avons rencontré. En plein mouvement social historique contre la réforme des retraites et de débats parlementaires cette semaine, il nous semblait plus que nécessaire de dialoguer avec lui, qu’il nous insuffle ce “Désir de communisme” face au “rouleau compresseur du capitalisme néolibéral”, concrétisé dans son dernier livre co-écrit avec Judith Bernard. L’occasion de se demander pourquoi la question du travail, si centrale pourtant, est si peu ou mal abordée à gauche et même au sein de la gauche dite “radicale”, comment retrouver un second souffle de mobilisation face à la régression des retraites, et qu’est-ce qu’apporte le mouvement des Gilets jaunes au combat social ? Entretien, par Selim Derkaoui et Nicolas Framont.
Dans votre prochain livre, “Un désir de communisme”(des conversations avec Judith Bernard à paraître en avril chez Textuel), vous réintroduisez un terme souvent discrédité encore aujourd’hui par nos ennemis idéologiques, et qui n’est pas forcément très parlant pour les dernières générations. De nos jours, à contrario, les gens de gauche ont plus ou moins tendance à se déclarer “anti” quelque chose, comme “anticapitaliste” ou “antilibéral”. Comment l’expliquez-vous ? Cette réintroduction peut-elle être efficace ?
Quand j’appelle communistes des institutions comme le statut de la fonction publique ou le régime général de sécurité sociale, je les pose bien sûr comme prémices du communisme, pas comme communisme accompli ! Dans L’idéologie allemande, Marx et Engels désignent par communisme le « mouvement réel » de sortie du capitalisme dans la lutte de classes, et c’est une affaire de très longue haleine. Il faut des siècles pour passer d’un mode de production à un autre.
Mais, et c’est le point décisif, les institutions du nouveau sont déjà communistes, dans le capitalisme lui-même. Les qualifier d’anticapitalistes, c’est les désigner en creux, c’est d’un point de vue analytique s’empêcher de conceptualiser le nouveau en train de poindre ; et c’est, d’un point de vue militant, s’interdire de construire le « pour », le « oui » sans lesquels aucun mouvement populaire n’est durable.
Moi-même, militant communiste, j’ai pratiqué longtemps le déni sur la désignation comme communistes d’institutions concrètes conquises par les travailleurs organisés. Certes, je pourrais invoquer le fait que ma génération, parce qu’elle a été sur la défensive à cause de l’échec soviétique, a pratiqué l’autocensure sur le mot « communisme ». Mais ce déni avait à mon sens deux raisons de fond. La première, c’est la culture politique dans le parti communiste qui postule comme préalable la prise du pouvoir d’État rendant possible une phase socialiste, et ensuite seulement le passage au communisme. Que le programme que l’on porte ou les réalisations émancipatrices dont on est les héritiers puissent être appelés “communistes” n’est pas pensable. Le Parti communiste considère que son programme des années 70, c’est une “démocratie avancée”. La lecture qu’il fait des institutions imposées à la Libération, comme le régime général de la sécurité sociale, c’est que ce sont des « avancées démocratiques ». Dans une telle culture, les qualifier de communistes alors qu’il n’y a eu ni prise du pouvoir d’État ni étape socialiste, cela n’a pas de sens – pire, c’est vu comme nourrissant des illusions sur des « îlots communistes » dans le capitalisme.
La seconde raison du déni d’existence d’un déjà-là communiste tient à la position de classe fréquente chez les chercheurs en science sociale critiques du capitalisme. Nous sommes critiques d’un capitalisme analysé comme un système dans lequel il n’y a qu’une seule classe pour soi, la bourgeoisie. En face il y a des « victimes » ; il peut certes y avoir des rapports de force provisoirement favorables aux travailleurs, mais c’est provisoire, et les droits sont grignotés assez vite ; il peut y avoir de la dissidence, il peut y avoir de la révolte, mais il n’y a pas de classe révolutionnaire pour soi. L’idée même que des travailleurs aient pu créer des institutions macrosociales durables alternatives à celles du capital est complètement étrangère à la recherche en science sociale critique, qui attend le salut pour demain. Et quand on est solidaires de victimes, on lit les documents – qui, et c’est tout le problème, ne répondent qu’aux questions qu’on leur pose – comme racontant cette histoire. J’ai été bien sûr marqué par cette lecture peu dialectique du capitalisme, une structure qui ne change que pour se reproduire. Même la lecture de Marx, qui, à la suite de Hegel, pose au cœur de la dynamique sociale non pas la domination, mais la contradiction, n’a pas suffi pour me libérer de cette position de soutien à des victimes qui empêche évidemment de sortir de l’impasse d’une attente du communisme pour demain. Pour que je bouge, il a fallu que la lecture de Marx se double d’une expérience sociale liée à l’échec répété des mobilisations contre la réforme des retraites depuis la fin des années 1980.
Je suis d’abord sorti de la séquence prise du pouvoir d’État/socialisme/communisme sous l’influence de la lecture de Lucien Sève, un philosophe qui a eu des responsabilités politiques importantes à la direction nationale du Parti, et qui fut longtemps le directeur des Éditions Sociales. Au moment où j’ai adhéré au parti est paru son Marxisme et théorie de la personnalité dont la lecture m’a beaucoup marqué. Depuis les vingt dernières années, il se consacre à l’écriture d’un très important ouvrage en quatre tomes, Penser avec Marx. Le quatrième tome porte sur le communisme. Il est en deux volumes dont le premier est sorti l’an dernier. En 1999 publiait à La Dispute son Commencer par les fins : la nouvelle question communiste dont la lecture m’a conduit à écrire pour Les Temps Modernes en 2000 un article intitulé “Pour un imaginaire communiste du salaire”. Mais c’est encore l’imaginaire qui était mobilisé, alors que, mouvement réel de sortie du capitalisme dans la lutte de classes, le communisme est une réalité empirique et est, par définition, déjà-là.
C’est l’échec des mobilisations contre la réforme des pensions dont les mots d’ordre mettaient, à tort, le régime général et l’Agirc-Arrco dans le même sac de la (bonne) répartition contre la capitalisation posée comme l’objectif des réformateurs, qui va me conduire au cours des années 2000 à analyser la contradiction, à repérer l’existence d’une classe révolutionnaire pour soi et la subversion des institutions du capital qu’elle a commencé à initier. Le régime général et l’Agirc Arrco ne sont pas du même côté dans la lutte de classes, le premier est communiste et le second est capitaliste, alors qu’ils sont tous les deux en répartition.
En créant le régime général en 1946, Ambroise Croizat étend au privé la logique de la pension comme salaire continué déjà mise en place pour la fonction publique, et Marcel Paul fait la même chose dans le statut des électriciens-gaziers de l’EDF-GDF. La qualification (OHQ, indice 575, etc…) et le salaire qu’elle détermine ne sont plus liés au poste de travail chez les retraités, ils sont attachés à leur personne même, comme dans la fonction publique, où la qualification est un attribut de la personne dans le grade dont elle est titulaire. Les retraités ne sont pas d’anciens travailleurs, ce sont des travailleurs libérés du marché du travail parce que devenus titulaires de leur qualification et donc de leur salaire. Cette libération est une telle menace pour la classe dirigeante qu’elle va dès 1947 instituer un contre feu aux initiatives communistes de 1946 : le régime complémentaire des cadres, que le patronat n’aura de cesse d’étendre dans l’Arrco à tous les salariés du privé (avec la complicité de FO qui joue à l’époque le jeu de la CFDT d’aujourd’hui), institue les comptes à points qui replacent les pensions dans l’étau de l’emploi.
« Les retraités n’ont pas droit au salaire, ce sont d’anciens travailleurs qui ont droit au différé de leurs cotisations. Ils ont été solidaires lorsqu’ils ont mis une partie de leur salaire au pot commun. A eux maintenant de bénéficier de la solidarité intergénérationnelle » : C’est là la définition capitaliste du travail : ne travaillent que les employés qui mettent en valeur du capital, et ils le font en se soumettant au marché du travail. Loin d’être l’histoire lisse de la réalisation du programme du CNR dans l’union des communistes aux gaullistes, comme le veut la saga, les années 45-47 sont des années de lutte de classe intense dans lesquelles, en 1946, les communistes subvertissent la sécurité sociale telle qu’elle existe en 1945 (elle avait été construire sur initiative patronale depuis la fin du 19ème siècle) en commençant à libérer les travailleurs du marché du travail, et les patrons ripostent dès 1947 en y soumettant à nouveau les cadres du privé.
En quoi est-ce d’actualité ?
Mais c’est tout l’enjeu de la réforme Macron des retraites ! La spécificité de cette réforme, ça n’est pas l’organisation de la baisse des pensions : toutes les réformes menées depuis la fin des années 1980 aboutissent à ce résultat, et le taux de remplacement du dernier salaire dans la première pension est passé (pour une carrière complète dont la durée a augmenté) de 84% à 75%. La réforme Macron va continuer cette dérive mais sa singularité n’est pas là. La force de la classe ouvrière comme classe révolutionnaire s’attaquant au statut capitaliste du travailleur est telle qu’aujourd’hui, 70 ans plus tard, les pensions sont encore pour les trois quart (240 sur les 320 milliards) la poursuite du salaire et non la contrepartie des cotisations de carrière, dont il n’est tenu aucun compte dans le calcul de la pension, qui vise à remplacer le salaire de référence. D’où l’acharnement de Macron à en finir avec le droit au salaire des retraités pour réaffirmer que ne peut avoir cours que la pratique capitaliste de la valeur : seuls travaillent ceux qui mettent en valeur du capital et la qualification ne peut pas être attachée à la personne. Les travailleurs sont nus sur le marché du travail, ils y acquièrent des points de retraite mais il est hors de question qu’ils soient vêtus de la qualification et deviennent, en tant que personne, titulaires à vie d’un salaire. Or cet enjeu majeur est totalement absent du débat public parce que la conquête de la souveraineté sur le travail, et donc sur la valeur, sur ce qui est produit, où, par qui, comment, n’est pas à l’ordre du jour des syndicats et de la gauche. La mobilisation porte sur le partage de « la valeur » et non sur sa définition et sa pratique, et donc sur ses institutions centrales que sont le statut du producteur et le régime de propriété.
Vous avez parlé de “classe ouvrière”. Quelles différences faites-vous avec “prolétariat”, ou “salariat” ? Quelle est la terminologie la plus juste afin de désigner les travailleuses et travailleurs ?
Classe ouvrière est un mot qui a du sens car les ouvriers ont été la fraction la plus organisée et déterminée de cette classe révolutionnaire en constitution autour des institutions du salaire. Mais je désigne la classe révolutionnaire comme étant le salariat, donc c’est beaucoup plus large que la classe ouvrière. Je n’utilise pratiquement jamais le mot prolétariat, car il définit la classe révolutionnaire par son manque. En effet, ce n’est pas parce qu’on n’a que ses chaînes à perdre que l’on cherche à les briser, encore faut-il être positivement défini, reconnu comme capable de produire de la valeur dans un salaire à la qualification personnelle et non pas comme un individu libre sur le marché, à poil : prolétaire, justement.
Est-ce que “salariat”, ça parle ? Et parler de “classe laborieuse” ?
Là, vous me prenez de court car je n’utilise jamais le terme de classe laborieuse et je n’ai pas réfléchi à son caractère mobilisateur. S’agissant du terme « salariat », il est possible que des travailleurs indépendants ou des précaires ne se retrouvent pas spontanément dans ce terme couramment assimilé au contrat de travail avec un employeur. Je le propose pour désigner la classe révolutionnaire, car l’intérêt de « salariat », c’est un peu comme « bourgeoisie » : c’est un terme qui exprime une classe à partir d’institutions d’émancipation. La bourgeoisie désigne l’émancipation des bourgeois du statut féodal de serf. Et le salariat c’est précisément ces travailleurs qui, en revêtant une qualification et en gérant l’équivalent du budget de l’État dans le régime général entre 1946 et 1967, font éclater les institutions bourgeoises du marché du travail et de son chantage à l’emploi.
Mais pour préconiser « salariat » et y englober les précaires, les indépendants ou les retraités, il faut mener la guerre des mots sur le mot “salaire”. Loin d’être une institution à la base du capitalisme, le salaire s’est construit tardivement, après le Code du travail de 1910, par imposition au patronat de la qualification, attachée au poste dans les conventions collectives et à la personne même du travailleur dans la fonction publique ou chez les retraités. Le salaire à la qualification personnelle, c’est l’antithèse du prix de la force de travail, qui lui correspond au statut capitaliste du producteur : la rémunération capitaliste lui attribue le pouvoir d’achat nécessaire à la satisfaction de ses besoins pour faire telle tâche de valorisation du capital. En-dehors de cette tâche, il n’a pas droit à rémunération, il est « hors travail » et ne peut bénéficier que du différé de la part de sa rémunération qu’il n’a pas consommée. Au contraire le titulaire d’un salaire à la qualification personnelle n’est jamais « hors travail », que cette non reconnaissance comme travailleur soit l’insertion « avant le travail », le chômage pendant le travail ou la retraite « après le travail ». Alors que la rémunération capitaliste est quémandée sur le marché du travail ou sur celui des biens et services par des individus nus (mais dotés d’un compte individuel de points à la mesure de leur performance sur ces marchés qu’ils ne maîtrisent pas), le salaire à la qualification personnelle, droit politique de la personne, fait du travail une réalité intrinsèque et non plus étrangère parce que chasse gardée de la bourgeoisie. Le salaire ainsi conquis par les travailleurs organisés au cours du 20ème siècle fait l’objet d’une guerre de classe de la part de la bourgeoisie, qui trouve des alliés dans tous ceux qui à gauche disqualifient le salaire. La force de la bourgeoisie, c’est de faire forger par ses adversaire le récit dont elle a besoin.
Quel récit ?
Le récit que le salaire, c’est une institution du capitalisme, et non pas, sous sa forme de salaire à la qualification personnelle, une institution du communisme. C’est à dire un récit qui ôte toute puissance d’agir à ceux qui sont dominés. Si vous disqualifiez comme défaites les conquêtes de travailleurs organisés, qu’est-ce qu’ils peuvent faire ? Si vous dites que le contrat de travail, le salaire, ce sont des institutions à détruire, vous niez le déjà-là révolutionnaire, vous réduisez les travailleurs à des victimes incapables de faire advenir une alternative, vous ôtez tout tremplin à la lutte pour sortir du capitalisme. Vous condamnez les mobilisations à la défensive au lieu de les organiser de sorte que se poursuive la conquête d’un droit politique au salaire qui confirmera tout adulte comme capable de produire de la valeur de 18 ans à sa mort et le reconnaîtra comme tel par une qualification personnelle rendant impossible tout recul ou suppression de son salaire.
A quel moment il y a un eu un basculement à gauche de ce point de vue-là ?
Depuis toujours ! La force de la bourgeoisie, je le répète, c’est de faire écrire par ses adversaires le récit dont elle a besoin. Prenons par exemple la thèse de la régulation. Cette thèse, écrite dans les années 70 par des intellectuels de gauche, énonce qu’il y aurait eu une phase “fordiste” dans le capitalisme, une phase dans laquelle le profit était recherché par les économies d’échelle : la production de masse qui en découle devait être vendue et pour ça il fallait rendre la population solvable. Et la sécurité sociale, ça aurait été un moyen de rendre solvable tout le monde, notamment les retraités. Nous avons donc des intellectuels de gauche qui écrivent le récit dont la bourgeoisie a besoin : « il n’y a qu’une seule classe pour soi et en 1945, les travailleurs qui se sont battus pour la sécurité sociale ont été les idiots utiles du capital, car derrière toute institution il y a toujours la main du capital. » Dans la science sociale critique, car encore une fois je ne parle que d’auteurs de gauche, il n’y a pas de lutte de classes fondamentalement, si par lutte de classes on entend deux acteurs. Il n’y a qu’un acteur : la bourgeoisie.
Comment l’expliquez-vous ?
Disons que c’est une position assez confortable. Parce que vous êtes du bon côté, de ceux que vous appelez “victimes”. Vous leur faite une violence considérable en les appelant victimes, mais vous êtes de leur côté. Et en même temps, vous allez avoir l’écoute de directions politiques ou syndicales qui ont connu un déplacement vers la fonction tribunicienne de soutien à des victimes, faute d’avoir poursuivi l’offensive sur le remplacement des institutions capitalistes du travail.
Le mouvement des gilets jaunes a un peu fait voler en éclat tout ça, non ?
Toute cette conjonction de la science sociale critique et des directions politiques est sur la défensive, et en assez grande difficulté pour proposer une alternative. Cette impuissance de ceux qui ont organisé les conquêtes dont j’ai parlé et qui aujourd’hui se révèlent incapables de les promouvoir, incapables de les voir même, fait qu’ont commencé à prospérer d’autres formes de discours et d’action comme les gilets jaunes, qui sont un mouvement de fond inscrit dans la durée.
Les gilets jaunes, à travers des formes d’organisation beaucoup plus horizontales, rejoignent d’autres formes de mobilisations nouvelles, toute cette jeunesse souvent diplômée qui crée des alternatives “ici et maintenant”, dans des tas de champs de la production. On a maintenant toute une marge alternative, communiste à mon sens, de gens qui se destinent à maîtriser leur travail. Cela a toujours existé mais à l’échelle atteinte aujourd’hui, c’est tout à fait nouveau. Cela vient de la crise du capitalisme qui est tellement avancé dans l’élimination du travail vivant par le travail mort des machines qu’il se heurte à de graves problèmes de valorisation qu’il ne parvient pas à juguler par la fuite en avant qu’il pratique à grande échelle.
Quelle en serait la suite logique ?
La rupture de tous ces alternatifs avec la logique capitaliste du travail me semble durable. Avec ses ambiguïtés certes. Ils ont tendance à confondre le marché du travail et les employeurs et avec les conquêtes du salariat : “la retraite, on n’en aura pas”, “non non surtout pas de CDI, je veux rester flexible” … Avec l’illusion que sur les plateformes collaboratives, on va être dans l’horizontalité, on va faire ce que l’on veut… Et la tentation d’adhérer au projet capitaliste qui se substitue au salaire à la qualification personnelle : nos personnes ne peuvent pas être titulaires d’un salaire, mais elles pourraient disposer d’un revenu de base. Il y a donc des illusions mais il y a quelque chose de magnifique à refuser d’être le jouet du capital.
Ces alternatifs sont dans cette situation ambiguë d’une adhésion de fait à une flexibilité recherchée par la bourgeoisie capitaliste, mais pour poser des actes de productions communistes, c’est-à-dire sur des produits qui aient du sens, qui ne soient pas faits pour mettre en valeur du capital, etc. Le dépassement de cette contradiction, ce n’est pas que ces producteurs deviennent des employés, avec un emploi stable auprès d’employeurs, mais qu’ils soient propriétaire de leur qualification et donc titulaires d’un salaire à vie.
Qu’est ce que cela signifie ?
Que l’enjeu pour les livreurs de Deliveroo n’est pas qu’ils deviennent employés de la plateforme mais qu’ils soient titulaires de leur salaire et copropriétaires d’usage de la plateforme, sous une forme coopérative ou autre. Une des choses les plus difficiles vient de ce que la bourgeoisie, qui s’emploie en permanence à disqualifier les institutions qui la mettent en difficulté, a tout fait pour que nous connotions négativement le salaire et positivement le revenu de base. Certes ils ont pour point commun de faire de la ressource un droit politique de la personne. Mais il y a un gouffre entre le pouvoir d’achat minimum que la bourgeoisie est toujours prête à accorder à quiconque dans un revenu de base (surtout s’il est payé par l’impôt, c’est-à-dire assez peu par elle), et la reconnaissance inconditionnelle, dans un salaire à la qualification personnelle, de la capacité de tout adulte à produire de la valeur. Un tel droit politique au salaire pose les personnes comme les seules productrices de valeur et donc candidates légitimes à ravir à la bourgeoisie son monopole sur la valeur économique, qui est le fondement de sa puissance.
Si la bourgeoisie est la classe dirigeante c’est parce qu’elle dirige le travail, et non pas parce qu’elle est riche. C’est le travail qui est le cœur de la lutte de classes, ce n’est pas l’argent, l’argent c’est la conséquence du travail. Donc la classe dirigeante n’a de pouvoir sur l’argent que parce qu’elle a le pouvoir sur le travail, et c’est son pouvoir sur le travail qu’il faut lui ravir. Et pour le lui ravir il faut d’abord que nous sortions de l’aléa de notre reconnaissance comme travailleur selon le bon vouloir de l’employeur ou selon notre performance sur les marchés sur lesquels nous n’avons aucun pouvoir en réalité. La bourgeoisie tient ces marchés, soit du travail soit des biens et services, et si nos personnes sont niées comme productrices et que nous ne sommes reconnus comme producteur qu’à la mesure de nos performances sur les marchés qu’elle tient, elle a de longs jours devant elle. Mais elle n’en a pas parce qu’une classe révolutionnaire est en cours de constitution depuis plus d’un siècle et institue l’alternative.
Vous pensez que la gauche a abandonné la question du travail ? Est-ce parce qu’elle est devenue un peu bourgeoise elle aussi ?
Devenir bourgeois c’est quand même précis : c’est être propriétaire de l’outil de travail, décider l’investissement, décider de ce qui vaut, par exemple arbitrer entre la route et le fer pour les transports. La gauche n’est pas devenue bourgeoise.
Mais qu’elle ait abandonné la question du travail, oui. Pour moi, c’est un manque tout à fait considérable. Augmenté encore par cette espèce de fascination pour la financiarisation du capital dans laquelle on nous fait croire qu’il se crée de la valeur dans la sphère de la finance, que finalement le capitalisme n’a plus besoin du travail, que tout ça va pouvoir être fait par des robots, que c’est la fin du travail… c’est dans l’air du temps, bien sûr.
Le mot « argent » l’emporte dans le débat public sur le mot « travail » : on a l’impression que l’argent fait des petits tout seul et que le capitalisme serait en mesure de se passer du travail et donc, qu’il faut lui prendre son pouvoir sur l’argent, que c’est ça qui est décisif. Quand on regarde les propositions alternatives, par exemple à propos de la retraite, elles portent sur le financement des pensions : on peut prendre l’argent là où il est car de toute façon « de l’argent, il y en a ». Mais il est mal réparti, il y a un coût du capital, … c’est ça le fond de l’argumentaire du mouvement progressiste. La solution, c’est une « bonne » fiscalité… Alors voilà le constat : la prise du pouvoir sur le travail n’est pas à l’ordre du jour globalement, sauf chez ces jeunes alternatifs… chez eux oui, c’est très puissant. Mais dans les organisations qui ont été porteuses des conquêtes du salariat, ce qu’on associe à « travail » c’est « souffrance ». Et c’est « réduction ».
Ce sont les mots les plus associés au travail aujourd’hui chez les militants ?
Je n’ai pas fait de lexicométrie à ce propos, mais je pense que les mots les plus associés au travail aujourd’hui, dans les milieux progressistes, ce sont en effet bien eux. Il s’agit de réduire le temps de travail et il y a de la souffrance au travail. C’est-à-dire que le mot travail est connoté négativement. C’est assez rare qu’il soit connoté positivement. Y compris chez les alternatifs qui, justement, parce qu’ils ne veulent pas faire du travail comme leurs aînés, en acceptant des travaux avec lesquels ils seraient en désaccord, vont dire qu’ils ne travaillent pas, vont dire qu’ils sont dans l’activité.
Ça correspond à une vision elle aussi péjorative du travail chez ceux qui aspirent à se libérer du travail, à réduire le temps de travail, et vivent le travail comme de la souffrance qu’il faut gérer. Il faut donc « prévenir la souffrance au travail », faire condamner les employeurs qui génèrent de la souffrance au travail. Mais la souffrance au travail c’est un concept qui est accepté. C’est une sorte de catégorie qui médicalise une violence sociale qui n’est pas dénoncée comme telle. Ce qu’on va condamner, c’est la souffrance qu’elle génère, comme si c’était naturel que le travail génère de la souffrance. Et pourtant les origines de la souffrance au travail sont claires : c’est l’absence de la maîtrise du travail. Donc tant qu’il n’y aura pas détermination à construire les institutions de pouvoir sur le travail, concret, dans l’entreprise, on va continuer à chercher à gérer la souffrance au travail et à chercher à réduire le temps de travail.
Est-ce que ça vient d’un manque de courage à affronter cette question ?
Je sais que c’est dur d’être militant, d’être syndicaliste, j’ai le plus grand respect pour tous ceux qui se battent. C’est plutôt qu’il n’y a pas de tradition de maîtrise collective du travail… On dit, « c’est nous qui produisons, c’est nous qui décidons », mais un peu comme un mantra, c’est comme le « tous ensemble tous ensemble hé » dans les manifs, quand on sait bien qu’on n’est pas tous ensemble et que trop d’organisations se tirent les unes sur les autres …
Rien de concret n’est fait dans les entreprises par les organisations de travailleurs pour qu’ils décident. Parce que décider, ça veut dire s’opposer aux directions. Et s’opposer aux directions ça ne se fait pas par la grève. La grève, c’est un temps pratiquement inexistant dans le secteur privé et très intermittent dans le secteur public. Donc non, ce n’est pas par la grève qu’on s’oppose aux directions, et comme aujourd’hui il n’y a que ça comme moyen d’action, la grève comme absence de travail, on ne mobilise pas toute l’organisation – les militants, les institutions, les protections (par exemple la protection contre le licenciement des délégués syndicaux), on ne mobilise pas toute cette organisation pour dire « ah non non, nous allons nous auto-organiser dans ce que nous faisons au travail ».
C’est ça la réponse à la souffrance au travail. Il n’y a aucune raison que le travail soit source de souffrance, aucune. Au contraire, c’est une source de liberté. Le déplacement à opérer dans l’action collective est autour de « nous nous auto-organisons ». Mais si la maîtrise du travail est abandonnée aux employeurs et que le temps de travail devient insupportable, toute la militance se consacre à la réduction du temps de travail, hebdomadaire et sur le cycle de vie, avec la retraite comme fin du travail. Alors que la retraite, rappelons-le, a été construite en 1946 par les communistes comme la fin de l’obligation d’aller sur le marché du travail pour avoir un salaire. Un retraité ce n’est pas quelqu’un qui ne travaille plus, c’est quelqu’un qui n’a plus besoin de quémander son salaire auprès d’un employeur parce qu’il est devenu titulaire de son salaire. C’est pour cela que vous avez une telle détermination de Macron : « non, entrer en retraite c’est être bénéficiaire du différé de ses cotisations, on ne peut jamais être titulaire de son salaire ». La bourgeoisie a absolument besoin que nous soyons à poil pour que sa domination sur nos vies soit possible, pour que nous ne puissions pas lui ravir le monopole sur la production de valeur qui est la source de son pouvoir.
Pour autant, cette question est totalement absente du débat public sur la réforme des retraites en ce moment …
Vous avez raison, et c’est parce que le travail, connoté négativement, est absent du débat public. Cela dit, je suis optimiste sur le fait que le travail vienne sur le devant de la scène. La prise de conscience que la maîtrise du travail concret doit devenir le cœur de l’activité collective, ça je suis convaincu que ça va monter. Déjà, il y a tous les alternatifs qui en sont porteurs, et tous les militants syndicaux qui voient bien qu’on ne peut pas se contenter de réduire le temps de travail et d’attendre la retraite comme la fin du travail, et qu’il faut commencer à se poser la question de la conquête des outils de l’affrontement aux directions sur le contenu du travail.
Que penser du traitement médiatique du travail ?
Je suis peu au fait du traitement médiatique, mais ce qui me frappe c’est la montée au cours des trente dernières années, dans l’opinion courante, de la connotation péjorative du travail. Jusqu’à son étymologie, avec l’invention d’une étymologie fausse, le fameux « tripalium », cet instrument de torture. Est tout à fait significative la façon dont Hannah Arendt, dans son essai sur La condition de l’homme moderne, prolongé par Dominique Méda dans la Fin du travail ?, reprend le triptyque aristotélicien sur travail, action, œuvre : le travail ce sont les esclaves, l’œuvre ce sont les artisans et l’action ce sont les citoyens libres, c’est la politique. Ce bouquin a eu un très grand succès, et les années 90 sont des années où dans l’opinion cultivée s’exprime cette dévalorisation du travail qui naturalise l’état déplorable dans lequel la logique du profit met le travail. Et c’est une saga qui, là encore, écrit ce dont la bourgeoisie a besoin.
Cette disqualification du travail vient de la crise du capitalisme : la bourgeoisie n’est plus capable de gérer le travail de façon à ce qu’il soit anthropologiquement, écologiquement, territorialement humain. Incapable de nous mobiliser positivement sur le travail, elle nous mobilise sur des colifichets de la consommation et s’emploie à ce que nous considérions comme naturel que le travail, c’est de la merde. Raison de plus pour nous appuyer sur le déjà-là communiste pour soutenir l’action collective de conquête de la souveraineté sur le travail afin de le tirer de ce mauvais pas. Nous disposons, avec la sécurité sociale de la production de soins que le régime général a su mettre en place de la fin des années 1950 au milieu des années 1970, d’un dispositif que nous pouvons transposer à toute la production. Une hausse du taux et un élargissement de l’assiette de la cotisation à l’assurance-maladie ont permis d’une part de subventionner l’investissement hospitalier, d’inclure dans son sein les hôpitaux psychiatriques, de transformer les hospices en hôpitaux locaux, et d’autre part de conventionner les soins de ville. Et ça s’est fait sur un mode que je qualifie de communiste : salaire à la qualification personnelle des soignants, fonctionnaires hospitaliers ou libéraux conventionnés, subvention de l’investissement ôtant toute place à la propriété lucrative de l’outil.
Je crois que vous avez des propositions qui s’appuient sur cet existant ?
Oui, l’application d’une telle sécurité sociale à l’alimentation (SSA) par exemple est un terrain d’autant plus propice qu’il y a déjà des alternatifs à tous les niveaux : de la production des biens bruts comme le lait ou le blé, à la production des biens élaborés, la distribution, la restauration, la production d’outils agricoles : tout cela aujourd’hui est investi par des alternatifs qui ne sont plus quantité négligeable, même s’ils restent marginalisables ou récupérables… Le levier serait une cotisation qui pourrait être de 8% de la valeur ajoutée marchande, soit 120 milliards, ce qui correspond en gros à la moitié des dépenses de consommation alimentaire aujourd’hui – ce qui n’est pas rien, et qui serait une opération blanche à l’échelle macro pour les entreprises, puisqu’à ces 120 milliards de cotisation correspondront 120 milliards de non remboursement de dettes, ou de non-versement de dividendes. Ça suppose toute une bataille politique sur l’illégitimité du crédit…
On n’affecterait pas la totalité de ces 120 milliards à solvabiliser la population, parce que les alternatifs ne peuvent pas aujourd’hui assurer la moitié des besoins d’alimentation. Disons pour lancer le débat qu’on peut proposer d’affecter les 2/3 des 120 milliards aux consommateurs/usagers, soit 100€ par personne et par mois, sur la carte vitale. Un foyer de 3 personnes perçoit dont 300€ par mois, ça ne couvre pas la totalité de la dépense en alimentation, mais c’est quand même très significatif. Et cette carte vitale, elle ne pourra être présentée que chez des professionnels conventionnés– exactement comme pour les hôpitaux et les médecins libéraux. On ne va évidemment pas conventionner la grande distribution, l’agrobusiness etc. Et il faudra aller loin dans le refus du conventionnement : un des enseignements qu’on peut tirer de l’assurance maladie, c’est qu’on a conventionné les producteurs de soins en conservant un mode capitaliste de production du médicament, moyennant quoi on a fourni un marché public incroyable aux groupes capitalistes comme Sanofi qui ont investi, et en partie pourri, la pratique du soin… Il ne s’agit pas qu’on fasse la même chose dans l’alimentation en fournissant un marché public à Massey Ferguson ou à Bayer ! Il faut que ne soient conventionnés que les producteurs qui ne font pas appel à des fournisseurs capitalistes, qui produisent bio en respectant le droit du travail (ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui), des entreprises dont les travailleurs sont les propriétaires d’usage de leur outil de travail…
Quant au tiers restant des 120 milliards, il serait consacré au soutien des producteurs alternatifs. Il faut acheter des terres, notamment : il faut arracher la terre à la logique marchande et en faire un bien commun, et ça aussi c’est un travail considérable. Il faut payer les travailleurs conventionnés à la qualification personnelle. Il faut subventionner l’investissement de producteurs agricoles alternatifs, il faut aider les agriculteurs qui voudraient passer au bio à le faire –il y en a pour quatre ou cinq ans, avant que ce soit rentable, et pendant ces quatre ou cinq ans il faut qu’ils soient soutenus ; il faut soutenir la production de machines nouvelles, etc.
Et je voudrais conclure sur le fait que nous créons là une institution macroéconomique qui pourrait être articulée avec cette autre institution macro qu’est la retraite, entendue comme l’âge où l’on devient titulaire de son salaire sans plus passer par le marché du travail. On pourrait la fixer à l’âge critique sur le marché du travail, 50 ans. Les quinquagénaires retraités, dotés de leur salaire et d’une responsabilité d’auto-organisation des travailleurs, pourront évidemment investir massivement ces entreprises alternatives dont l’activité va être considérablement augmentée. Et ce qu’on vient de dire sur l’alimentation, on pourrait le transposer sur la production de logement, sur le transport de proximité, sur l’énergie, la culture, l’accès à la justice… Retrouver la dynamique communiste rend inventif et joyeux !