Sortir d'une lecture fiscale de la cotisation sociale
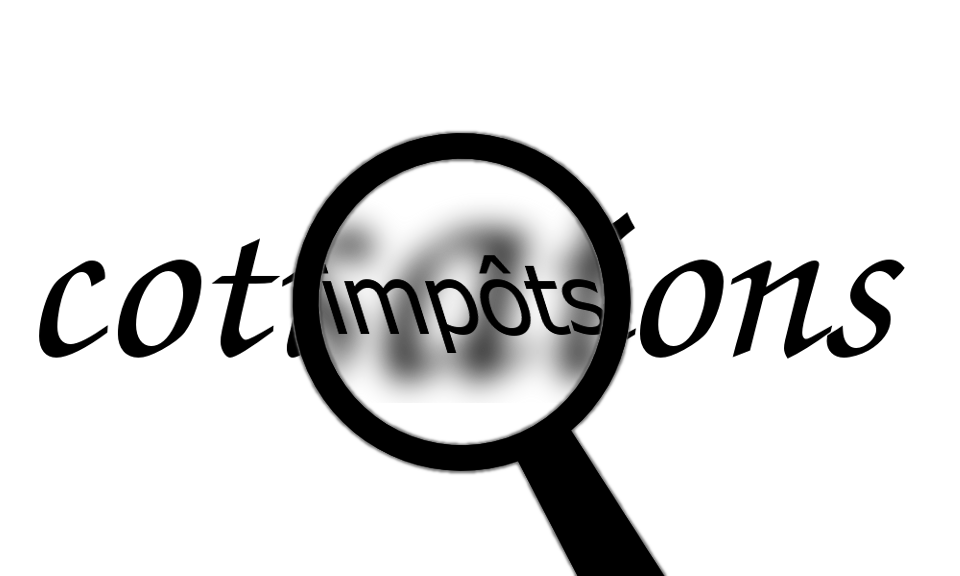
Dans leurs tribunes de novembre et décembre derniers, W. Baudrillart et G. Colletis ont argumenté le premier pour et le second contre la TVA comme moyen de financement de la sécurité sociale. Je voudrais argumenter ici pour la cotisation sociale contre tout impôt après avoir montré combien les adversaires de ce qui s’est construit en 1945, qu’ils soient de droite ou de gauche, ont déjà réussi non seulement à stopper la progression de la cotisation mais aussi, et c’est décisif, à déplacer le débat sur le seul terrain de la fiscalité. Sortir d’une lecture fiscale de la cotisation est la condition de la reprise de sa dynamique.
La pression pour remplacer la cotisation par l’impôt : une constante depuis 1945
Les pressions patronales, et plus généralement de la classe dirigeante, pour remplacer la cotisation sociale par l’impôt sont aussi vieilles que la sécurité sociale. Et la doxa académique participe activement à la tentative de disqualification du financement de la sécurité sociale par socialisation du salaire : dès la fin des années quarante, Paul Durand, directeur de Droit social et auteur du premier manuel de droit de la sécurité sociale, exalte Beveridge et sa fiscalité universelle contre Bismarck et sa cotisation corporatiste, et c’est encore le fonds de commerce de la typologie des régimes de protection sociale la plus utilisée aujourd’hui, celle d’Esping Andersen qui oppose les lumières « démocratiques » des régimes beveridgiens nordiques aux ténèbres « corporatistes‑conservatrices » des régimes bismarckiens continentaux.
La réforme fait régresser un taux de cotisation en progrès de 1930 à 1995
Constante, la pression contre la cotisation au nom de l’impôt a été relancée en France par la création de la CSG en 1990, premier acte de l’entreprise réformatrice que poursuivent depuis vingt ans, sans solution de continuité, les gouvernements de droite et de gauche. C’est ainsi que la dynamique qui avait porté la croissance de la sécurité sociale par croissance du taux de cotisation a été interrompue et inversée. Le taux de cotisation, créé dans les années 1920, porté de 16 à 32% du salaire brut plafonné en 1945 puis encore doublé dans les cinquante années suivantes pour atteindre 65% du salaire brut total au début des années 1990, a été depuis gelé (aucune hausse du taux depuis quinze ans, à l’exception de la minuscule hausse récente), amputé par la montée en puissance de la CSG‑CRDS (passée au cours des années 1990 de 1 à 8 points), réduit soit considérablement pour le Smic (de 26 points soit près de 5000 euros par an) soit de façon dégressive pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic qui est, rappelons‑le, le salaire médian, tandis que, dernière née des mesures prises pour le remplacement de la cotisation sociale par l’impôt, et gravissime parce qu’elle concerne les salaires inférieurs à 2,5 Smic, soit l’énorme majorité, les employeurs sont partiellement remboursés de leurs cotisations par un crédit d’impôt. Si bien que la cotisation, qui jusqu’aux années 1980 finançait 80% de la protection sociale, n’en finance plus que 60%, et le projet des réformateurs est qu’elle passe en‑dessous des 50%.
Les opposants à la réforme s’inscrivent dans le projet fiscal des réformateurs
La revendication de fiscalisation du financement, portée traditionnellement par le Medef, le Front National, l’UMP, le PS, les Verts et la CFDT, et mise en récit en particulier par T. Piketty et ses collègues dans La révolution fiscale, n’épargne plus aujourd’hui les syndicats et partis qui s’étaient opposés dans les années 1990 tant à la CSG qu’à la TVA. En témoigne la revendication de « taxer le capital comme le travail » popularisée dans la gauche de gauche depuis la lutte contre la réforme des pensions de 2010. On observe ainsi un consensus, nouveau, sur le fait que la cotisation est une « taxe sur le travail ». Les opposants à la réforme estiment qu’il faudrait, non seulement taxer aussi les revenus de la propriété des ménages comme le fait la CSG (au demeurant selon la technique de l’alouette et du cheval, puisque la CSG n’est assise sur ces revenus que pour 10%), mais encore taxer les revenus de la propriété des entreprises, et déplacer ainsi l’assiette de la CSG en réduisant celle du travail et en augmentant celle du capital. Si bien que la revendication de hausse du taux de cotisation a de fait disparu et que le débat public tend à se déplacer de l’opposition entre cotisation et impôt vers les oppositions internes à la fiscalité : le patronat et la droite s’accommodent de la CSG mais sont plutôt pour une poursuite de la réforme par la TVA qui épargne les entreprises et les ménages dont le revenu, élevé, est pour une part placé ; tandis que la gauche se partage entre les réformateurs partisans des exonérations de cotisation, du crédit d’impôt et d’une hausse du taux de CSG et leurs opposants partisans d’une taxation du capital et d’un glissement de l’assiette de la CSG vers les revenus financiers. Comment sortir de ce débat aliéné ?
Sortir du piège de la lecture de la cotisation et de l’impôt comme des « prélèvements » dédiés à la « justice sociale » et à la « solidarité »
La clé est dans la lecture de la cotisation pour ce qu’elle est, une alternative à la répartition de la valeur ajoutée entre salaires du marché du travail et profits de la propriété lucrative, et non pas pour ce qu’elle n’est pas, un impôt qui serait le correctif de cette répartition. L’impôt en effet est considéré, et pratiqué (dans sa collecte) comme la redistribution d’une valeur ajoutée préalablement répartie entre les salariés et les propriétaires lucratifs : la TVA va ponctionner les salaires et les revenus du patrimoine à l’occasion de leur consommation, tout comme l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés va le faire à l’occasion de la déclaration des revenus des personnes ou des résultats des entreprises. Ce « prélèvement obligatoire » est justifié essentiellement par deux arguments : la solidarité par réduction des inégalités de la répartition primaire des salaires et des profits, et l’accès non marchand à des consommations qui relèvent soit de la seule puissance publique (armée, justice, police) soit d’une régulation publique au nom de l’efficacité ou de la justice sociale.
La cotisation est aujourd’hui lue comme un impôt : un « prélèvement obligatoire » aux fonctions de solidarité et de justice sociale. Et depuis les années 1980, on attend aussi d’elle, comme de l’impôt, qu’elle soit « au service de l’emploi », d’où les propositions de modulation des cotisations selon le comportement de l’entreprise en matière d’emploi, tout comme il est proposé de taxer les contrats de travail courts.
Or, dans la réalité, ni la cotisation ni l’impôt ne sont des prélèvements sur la valeur créée par les salariés des entreprises privées. Les fonctionnaires de l’administration ou de l’école, payés par l’impôt, les soignants du service de santé ou les retraités pensionnés, payés par la cotisation, ne sont pas des improductifs : l’impôt et la cotisation expriment la valeur économique qu’ils produisent en ne mettant en valeur aucun capital et en n’étant soumis ni aux incertitudes du marché du travail ni à la dictature du temps de travail par unité produite, bref en étant libérés du chantage des employeurs et des actionnaires et de la mesure si mortifère de la valeur par le temps qui caractérisent les salariés du privé. L’impôt et la cotisation sont l’affirmation qu’il y a une autre façon de produire de la valeur économique que sous le carcan des marchés financiers, du marché du travail et du temps comme mesure de la valeur. Ce qui s’est construit au 20ème siècle avec la croissance de la place de l’impôt et de la cotisation sociale dans le PIB, c’est la preuve massive (plus du tiers du PIB est le fait des personnes payées par l’impôt et la cotisation) qu’il est possible de produire selon une convention de travail antinomique de la convention capitaliste. Et donc que si nos pays ont déjà pu libérer une telle part de la valeur de sa définition, de sa production et de sa répartition capitalistes, alors il est possible d’en libérer tout le PIB et de sortir du capitalisme.
C’est pourquoi la classe dirigeante est si acharnée à réduire leur place et à imposer son récit du réel selon lequel d’une part il n’y a de valeur que produite par les salariés du capital, l’activité des fonctionnaires ou des retraités étant une « dépense », la fameuse « dépense publique » de gens certes « utiles » mais « improductifs », et d’autre part services publics et sécurité sociale sont un correctif du capitalisme, nécessairement limité donc puisqu’il ne faudrait pas que les « prélèvements » qui les financent tuent leur assiette, le profit et les salaires du marché du travail.
Promouvoir une hausse massive du taux de cotisation à la place de l’impôt
Dans ces conditions, s’ils considèrent impôt et cotisation comme pesant l’un et l’autre sur les actifs et les entreprises du secteur privé, pourquoi les réformateurs sont‑ils si acharnés à remplacer la cotisation par l’impôt, la peste par le choléra ? Parce que la cotisation met en cause ce que l’impôt légitime. Elle est en effet un élément de la répartition primaire : la valeur ajoutée est partagée entre trois institutions concurrentes, le profit, le salaire lié au marché du travail et la cotisation. Le profit et le salaire du marché renvoient à la production capitaliste, et la cotisation fait sa place contre eux en se posant comme salaire socialisé, c’est‑à-dire comme expression d’un travail, et d’un travail alternatif au travail capitaliste dont elle appelle la disparition : le salaire socialisé peut s’étendre à tout le PIB. Des cotisations iraient à des caisses de salaire finançant le salaire à la qualification à vie de tous, de 18 ans à la mort : plus personne ne passerait par le marché du travail, la fonction d’employeur et le chantage à l’emploi disparaîtraient. Et des cotisations iraient à des caisses d’investissement subventionnant les entreprises : le profit, les marchés financiers disparaîtraient, et avec eux le chantage à la dette, tandis que la propriété d’usage de tous les lieux de travail par les salariés se substituerait à la propriété lucrative.
Cette perspective qu’ouvre la cotisation, l’impôt l’interdit : redistribution des revenus tirés du capital et du marché du travail, il est pratiqué comme un correctif de la répartition entre propriété lucrative et travail marchand, et réclame du profit et du marché du travail pour pouvoir être prélevé sur eux. Il ne faut pas sous‑estimer les effets cognitifs d’une institution. L’impôt pose les personnes comme des êtres de besoin qui ont droit à un pouvoir d’achat distribué le plus justement possible : c’est la place que leur laisse le capital. La cotisation les pose, contre le capital, comme les producteurs de la valeur économique en mesure de se libérer des employeurs et des actionnaires.









