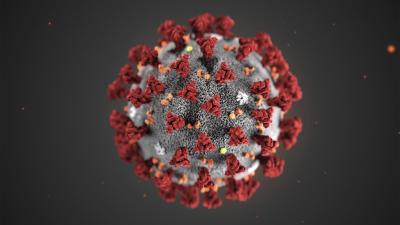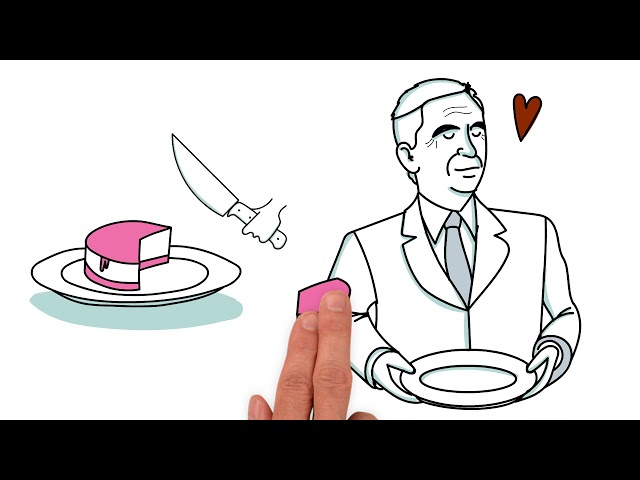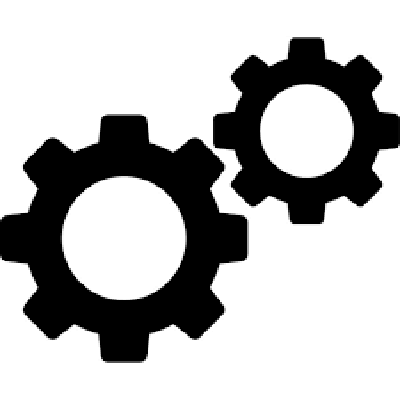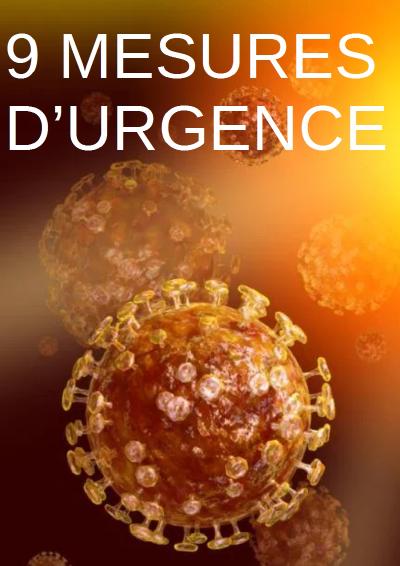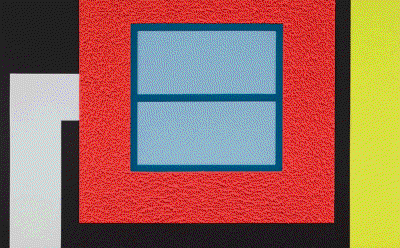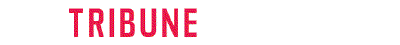Le salariat, une classe révolutionnaire ? — entretien avec Claude Didry
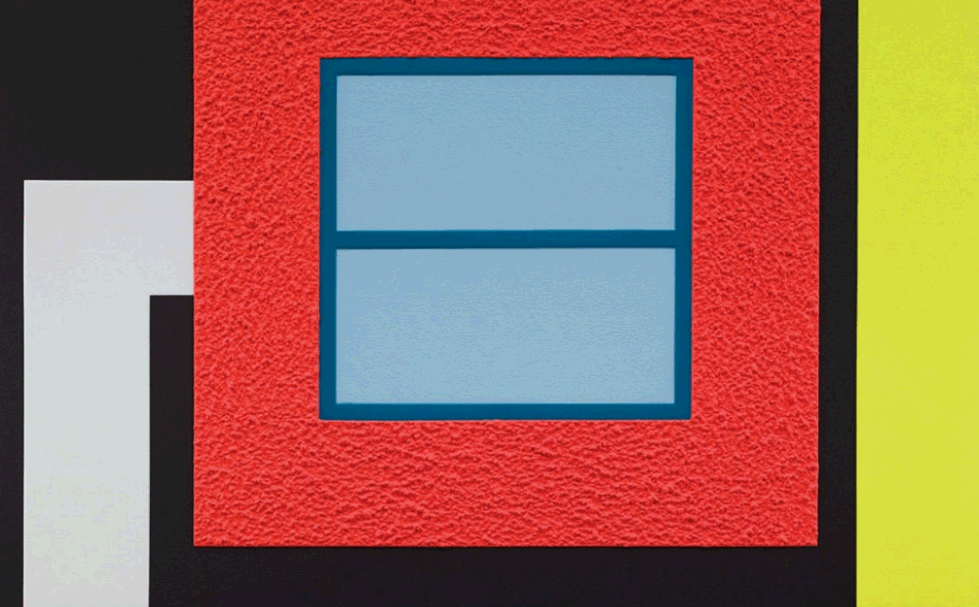

En dépit du confinement et de la crise sanitaire, on ne compte plus les livreurs de repas à domicile contraints de travailler, au mépris de leur santé et du contrôle de la pandémie. Un signe de plus du déficit de droits et de protections sociales dont ces travailleurs ont à souffrir.S’intéresser au droit du travail, dans une perspective historique, peut dès lors nous éclairer : c’est ce qu’a fait le sociologue Claude Didry, auteur deL’Institution du travail. Du « louage d’ouvrage » du XVIIIe siècle aux dernières attaques contre le code du travail, il replace ce droit dans les dynamiques au long cours qui l’ont façonné. Pour le sociologue, la mise en place du contrat de travail a valeur de «révolution» : il participerait à la mise en place d’un véritable monde du travail,redéfinissant ainsi ce que représente l’activité professionnelle et les institutions qui l’encadrent. Nous en parlons ensemble.

Un parallèle a parfois été établi entre la situation des coursiers à vélos et autres chauffeurs Uber comme un retour au louage d’ouvrage du XIXe siècle. Une comparaison pertinente ?
Elle me paraît pertinente, avec certaines réserves qui tiennent précisément à l’existence d’un droit du travail et à un nombre croissant de salariés dans la population française (89 % de la population active occupée en 2019). Il faut également avoir conscience que l’on parle d’une part très réduite de la population active (quelques dizaines de milliers de personnes sur 29 millions d’actifs), quand on envisage la situation des livreurs de repas et des chauffeurs de plateforme. Revenons rapidement sur la production marchande dominée, au XIXe siècle, par la référence au contrat de louage d’ouvrage établi par le Code civil de 1804. Pour répondre aux attentes de sa clientèle, l’entrepreneur/négociant doit fournir une marchandise qui nécessite une succession d’opérations, c’est-à-dire d’ouvrages, relevant de différents métiers. Le louage d’ouvrage1 caractérise la relation contractuelle qui se noue entre cet entrepreneur/négociant et l’ouvrier qui prend en charge un ouvrage, sachant que celui-ci peut engager d’autres ouvriers — par un second louage d’ouvrage — et/ou mobiliser sa famille : l’important est que todo modo l’ouvrage soit livré en temps et en heure.
Cela se retrouve en partie dans le cas des coursiers à vélo et des chauffeurs Uber. Les plateformes de ce type sont des dispositifs de centralisation de commandes et d’affectation de prestataires de service pour y répondre. Les chauffeurs et les livreurs entrent dans un contrat de prestation de service avec la plateforme, qui pose comme condition préalable l’indépendance de ces prestataires (avec inscription au registre du commerce), établissant une présomption de non-salariat. La plateforme est donc bel et bien dans une situation analogue à celle de l’entrepreneur/négociant — et le chauffeur/livreur endosse les rôles qui revenaient alors à l’ouvrier. Il arrive parfois que le prestataire enregistré auprès de la plateforme confie la prestation à une autre personne, qu’il rémunérera en prélevant éventuellement une commission.
Ces entreprises du « capitalisme de plateforme » ont subi des défaites judiciaires : les prud’hommes ont à plusieurs reprises requalifié des coursiers en salariés, la Cour de cassation a aussi tranché en ce sens, et récemment Deliveroo a été condamné pour travail dissimulé. Ces victoires annoncent-elles un tournant ?
La jurisprudence n’est pas une baguette magique qui transformera, du jour au lendemain, les travailleurs de plateforme en salariés. La portée du droit ne se révèle, en effet, que par les actions de ceux qui sont intéressés à sa revendication. Engager une action aux prud’hommes, cela prend du temps, avec une procédure plus compliquée depuis la loi « Macron » de 2015. Il faut ajouter ce que Max Weber présente comme « l’enchantement de la liberté » dans le cas des paysans attachés à la propriété de la terre, que l’on retrouve à travers l’illusion pour les prestataires indépendants de pouvoir obtenir une rémunération supérieure à celle à laquelle ils pourraient prétendre comme salariés, en sortant des cadres réglementaires sur la durée du travail et la cotisation sociale. Ceci étant dit, la requalification fait jurisprudence, avec un arrêt de la Cour de cassation le 28 novembre 2018 concernant un livreur de la plateforme Take Eat Easy (entretemps liquidée), puis un arrêt tout récent du 4 mars 2020 concernant un chauffeur de la société Uber qui marque un renouveau de la jurisprudence de la Cour de cassation2. Cette jurisprudence renforce le flux des actions engagées par des travailleurs de plateforme devant les conseils de prud’hommes, avec à la clé des dommages et intérêts substantiels.
Lesquels, par exemple ?
Dans un jugement du conseil de prud’hommes de Paris en février dernier, un livreur Deliveroo a obtenu près de 30 000 euros de dommages-intérêts, dont près de 20 000 pour travail dissimulé, auquel est venu notamment s’ajouter le dédommagement de la rupture abusive du contrat de travail. Le travail dissimulé — qui consiste en une non-déclaration de travail salarié à la Sécurité sociale — est un des éléments cruciaux des litiges, dans la mesure où la non affiliation de l’employeur à la sécurité sociale se traduit par une non indemnisation des immobilisations dues aux accidents du travail : il y a un préjudice pour le salarié immobilisé sans compensation, il y a un préjudice pour l’URSSAF, en charge du recouvrement des cotisations sociales3. Si le législateur et le gouvernement font pression pour retarder la montée du flux, les syndicats jouent un rôle très important. Ce dont témoigne la présence de la CGT aux côtés du livreur dans son action contre Take Eat Easy, ou celle de FO dans celle du chauffeur Uber dont la requalification a été confirmée le 4 mars dernier. Les arrêts de la Cour de cassation traduisent également un tournant majeur dans les rangs de magistrats et de juristes qui commencent à redouter le « recul du juge » orchestré par les réformes successives engagées depuis 2008. Ce tournant est donc attesté par une mobilisation de tous les acteurs concernés : les travailleurs eux-mêmes, l’URSSAF et les syndicats, avec un écho auprès des juges.
Vous écrivez que « la Révolution française a mauvaise réputation dans l’histoire du mouvement ouvrier » et qu’elle « ne se réduit pas à une révolution “bourgeoise”, reléguant au second plan les ouvriers ». Pouvez-vous expliciter pourquoi ?
Prenons un exemple. Dans la brève présentation historique du Précis Dalloz4, Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier insistent sur le caractère négatif de la Révolution dans le domaine du travail. Celle-ci interdit toute organisation ouvrière collective, dans la foulée de la suppression des corporations ; en retenant la loi le Chapelier de 1791, elle fait du louage de services5 la référence des rapports de travail en dissimulant des rapports inégalitaires sous un cadre contractuel. Et elle nie l’égalité civile entre ouvriers et patron6 — priorité aux dires du maître en cas de différends sur les salaires — et le livret ouvrier de 1803. Dans cette orientation historiographique, la condition ouvrière se définit par l’exclusion: à l’égard de la vie politique par le suffrage censitaire, de la vie économique par l’enfermement disciplinaire et de la vie sociale par la misère. Or, comme le montre Alain Cottereau7, la Révolution est traversée d’agitations ouvrières revendiquant le « vrai louage » entendu comme le louage d’ouvrage. La Révolution ne se réduit donc pas à une révolution bourgeoise, comme en témoignent la figure des ouvriers du Faubourg Saint-Antoine à Paris ou les initiatives de la soierie lyonnaise. Il faut également intégrer les agitations paysannes et saisir le rôle de la Révolution dans l’accès à la propriété de la terre. De plus, en suivant les enseignements d’Alain Dewerpe8 et de Gérard Noiriel9, la Révolution ne préfigure pas un ordre économique industriel construit autour de l’usine ; elle libéralise un régime diffus de production marchande urbaine et rurale, qui demeure dominé tout au long du XIXe siècle par l’artisanat à domicile et le textile. Enfin, ceux qui prennent part aux activités productives et, en leur sein, les artisans urbains (chefs d’atelier, compagnons), ne sont pas plongés dans la misère. Les penseurs — souvent réactionnaires — de la « question sociale » ont beau jeu de réduire les mobilisations ouvrières à des émeutes de la faim, pour éliminer la portée économique et politique des insurrections lyonnaises de 1831 et 1834. Les agitations ouvrières croisent en elles la revendication de tarifs, destinés à limiter la pression des négociants sur le prix des ouvrages, et l’espérance d’un régime républicain et socialiste renouant avec la Révolution10.
Dans l’entre-deux-guerres, les débats sur le sens et les implications du contrat de travail sont vifs : subordination juridique pour les uns, ouverture de droits pour les travailleurs par la reconnaissance de leur dépendance économique envers un employeur pour d’autres. Ces deux dimensions semblent encore coexister dans notre représentation du contrat de travail…
Le débat sur les critères d’identification du contrat de travail s’inscrit dans la grammaire plus générale de ce contrat. Avec le contrat de travail, le point de départ est le travail d’une personne dite travailleur, ce qui conduit à se demander ensuite si ce travail est régulièrement destiné à une (ou plusieurs) personne(s) pouvant être dite(s) employeur(s). Cela correspond au constat d’une prestation personnelle de travail, première condition pour établir l’existence d’un contrat de travail, à partir de quoi deux critères s’affrontent pour identifier un employeur : la dépendance économique (l’employeur est celui qui rémunère), la subordination juridique (le travailleur est sous l’autorité de l’employeur, l’employeur a un pouvoir de directive sur le travailleur). Prenons deux exemples tirés de la jurisprudence : en 1923, la cour d’appel de Poitiers reconnaît la responsabilité — comme employeur — d’un donneur d’ordres dans l’accident d’un bucheron sur une coupe, alors que ce bucheron intervenait sur la coupe sans avoir été engagé formellement. C’est la dépendance économique qui permet d’identifier un contrat de travail dans ce cas, en ouvrant l’application de la loi sur les accidents du travail11. En 1931, un rubanier stéphanois est radié des assujettis à la cotisation sociale, par un jugement du tribunal civil de Saint-Étienne, à la demande du fabricant pour lequel il travaille, au motif qu’il n’est pas « subordonné » au fabricant en tant qu’« entrepreneur d’ouvrage ». Ainsi, la subordination permet d’écarter l’existence d’un contrat de travail entre le fabricant/négociant et le tisseur à domicile, ce qui permet au fabricant d’échapper à la cotisation prévue par les lois de 1928–1930 sur les assurances sociales tout à la fois pour l’emploi du rubanier, et pour celui des ouvriers qui travaillent avec lui.
Mais on peut trouver dans le droit d’autres critères. Ainsi, une loi de 1935 identifie le journaliste à un salarié, selon un troisième critère, l’appartenance à une rédaction dans laquelle s’exerce l’activité permettant au présumé journaliste de gagner sa vie12. Le journaliste est un salarié, mais déchargé de la subordination par la clause de conscience, ce qui montre une orientation du législateur vers le critère de la dépendance économique, voire celui de l’appartenance à un « service organisé » sous la figure du comité de rédaction. Comme il n’y a jamais eu de définition légale du contrat de travail, le guide pour les juristes est la Cour de cassation. Or la Cour a un tropisme marqué pour la subordination juridique et l’assimilation de l’employeur à un « chef », notamment pour mieux limiter le déploiement de la législation sur les accidents du travail et les assurances sociales. Paradoxalement, c’est en créant une présomption de non-salariat pour les entrepreneurs individuels avec la loi Madelin de 1994, que le législateur a poussé la Cour à renforcer à nouveau la dimension autoritaire de la subordination pour justifier une vision limitative du salariat.
Le sociologue étasunien Immanuel Wallerstein considérait que ce n’est pas le changement du rapport de production — du servage vers le salariat — qui opère la bascule entre féodalisme et capitalisme, mais la mise en place d’un système de marché. Comment percevez-vous cette thèse ?
Comme sociologue, je suis tenté de faire entrer dans ce panorama une institution très importante, l’État, trop souvent conçu comme une pièce rajoutée par rapport au déterminisme en dernière instance des structures économiques (rapports de production, technologies et marché). L’État joue un rôle constitutif tout à la fois dans l’émergence de sociétés modernes, ainsi que dans la structuration physique (santé) et intellectuelle (scolarisation) des individus. Si les échanges marchands se développent depuis le Moyen Âge autour de foires, de villes franches, à l’ombre des pouvoirs féodaux, c’est l’État qui assure le développement d’échanges pacifiques (par la monopolisation de la violence physique et l’institution de la monnaie, puis l’institution d’une langue commune), encourage les échanges commerciaux (en France sous l’impulsion de Colbert, pour financer les guerres), fixe les cadres juridiques du commerce, garantit la qualité des produits à travers l’action d’inspecteurs, participe à la vie économique pour faire construire des châteaux, des fortifications, des vaisseaux de guerre, etc. L’État rend possible l’affirmation d’une bourgeoisie commerciale tournée vers le commerce lointain, mais très ancrée dans un cadre institutionnel. Je rejoins la thèse de Wallerstein, mais en parlant d’une « institution » du commerce et de la bourgeoisie commerciale plutôt que d’un « système de marché », terme marqué par un certain économisme. Toute cette histoire est continue, de sorte que la césure entre le couple servage/féodalisme et le couple salariat/capitalisme est trompeuse.
Qu’entendez-vous par continuation ?
La production marchande à la campagne, encouragée par le colbertisme, intervient dans le cadre d’un ancien régime qui laisse subsister nombre de vestiges du féodalisme — dont les ordres et les impôts qui les accompagnent, les corporations —, voire du servage. Les corporations elles-mêmes, connotées ancien régime et féodalisme, peuvent être d’excellents relais disciplinaires pour répondre aux commandes des marchands. Le régime du louage d’ouvrage et du marchandage, au cours du XIXe siècle, accompagne le développement d’un capitalisme commercial, voire quelquefois industriel, mais sans correspondre à ce salariat (concept abstrait qui ne trouve que peu d’écho dans les pratiques) enchaînant individuellement le prolétaire à un capitaliste imbu de son pouvoir qu’annonce le Manifeste. D’ailleurs, dans le Capital, Marx souligne l’importance prise par les « intermédiaires » sous l’empire du « salaire à la pièce » où « l’exploitation des travailleurs par le capital se réalise ici au moyen de l’exploitation du travailleur par le travailleur13. »
Pour vous, le salariat s’est notamment constitué par la mise en place d’un droit du travail. Le sociologue Bernard Friot s’attache à inscrire le salariat et les cotisations sociales dans une dynamique émancipatrice : un élan « communiste », pour reprendre un mot qu’il utilise désormais…
Le salariat identifié par Bernard Friot va au-delà du contrat de travail et de ce qu’il nomme l’« emploi » : il intègre le droit à la carrière et à la reconnaissance de la qualification personnelle (comme dans la fonction publique), ainsi que la socialisation du salaire grâce à la cotisation sociale dans le système de Sécurité sociale. Il se fonde sur les réalisations de la Libération, la Sécurité sociale sous l’impulsion de Parodi et surtout Croizat (de 1945 à 1947), le statut de la fonction publique qui reprend une longue série de projets pour aboutir en 1946, sous l’impulsion de Thorez. Bernard Friot souligne à juste titre que ce « déjà-là » du salariat reste à envisager dans toute son ampleur, dans la mesure où il est recouvert par une incapacité des forces de gauche — et notamment du Parti communiste — à assumer cet héritage.
Pour quel motif ?
Elles sont prises dans une dénonciation du capitalisme qui laisse peu de place à une analyse de son action dans la dynamique historique. Ce « déjà-là » est également recouvert par la vague idéologique des années 1990, qui prophétise la fin de l’État social et du droit du travail et annonce une « post-social-démocratie », ramenant le social à la charité publique face à la puissance inéluctable du « marché ». Mais ce « déjà-là », Bernard Friot l’a retrouvé à la manière d’un archéologue dans Puissance du salariat14, au cœur de ces années 1990 emportées dans la collapsologie du salariat. Selon lui, ce déjà-là porte un horizon révolutionnaire avec le salaire à vie, la qualification personnelle, la subvention d’investissement, la cotisation économique, etc15.
Et c’est un horizon que vous partagez ?
Je suis arrivé à des propositions proches de celles de Bernard Friot, en partant des limites dans la portée révolutionnaire du régime de l’« emploi » émanant du droit du travail. Le contrat de travail définit un espace de relations professionnelles en groupant dans un même ensemble (établissement, entreprise), les salariés liés à un même employeur16, ce qui conduit à l’organisation d’une consultation des salariés par l’intermédiaire de leurs représentants sur la gestion de l’entreprise. Mais on peine actuellement à saisir la figure de l’employeur, c’est-à-dire de l’entreprise qui est en fait une entité commerciale malléable et négociable selon les intérêts des actionnaires17. Or environ un tiers du budget de l’État (soit 140 milliards d’euros à ajouter aux 300 milliards des ministères18) subventionne directement les entreprises avec, manifestement, peu de résultats en matière d’emplois et d’investissements et un effet immédiat sur les dividendes des actionnaires. De là mon intuition d’une sécurité sociale industrielle.
Qui viserait… ?
À convertir ces subventions de dividende en subventions d’investissement par un soutien aux contrepropositions faites par les élus du personnel dans les restructurations, en arrivant à une « sécurisation » des collectivités de travail.
Mais la conscience de classe du salariat semble faible aujourd’hui…
Sur la base de ces analyses, il reste à concevoir la mise en révolution du salariat, comme classe révolutionnaire consciente de ses intérêts. Aujourd’hui, le salariat existe en soi, comme le montrent les enquêtes emploi de l’INSEE, mais ne dispose pas d’une claire conscience de ses intérêts. Cela tient à une série d’obstacles. Premièrement, la confusion entre lutte des classes et inégalités sociales, correspondant à ce que je vois comme l’héritage « ouvriériste » de la gauche syndicale et politique. La focalisation sur la subordination — au détriment de l’organisation — occulte la part croissante de salariés relevant de la catégorie des « cadres » et de la catégorie des professions intermédiaires tant dans des fonctions d’autorité, que dans des activités de recherche et développement. Deuxièmement, la division entre public et privé, conférant une grande portée aux discours présentant les fonctionnaires en « privilégiés » par la stabilité de l’emploi et le niveau des pensions de retraite. Troisièmement, un attachement à l’entreprise lié à la très grande stabilité des salariés, mais à une entreprise profondément instable.
Les événements actuels — mobilisation contre les retraites, coronavirus — auront de fortes conséquences pour le salariat. Par exemple, le partage entre les travailleurs en télétravail et les travailleurs « indispensables » peut renforcer le fort « ouvriérisme » existant dans certains syndicats. À l’inverse, la situation actuelle met bien en évidence le besoin de reconstruire un secteur public fort, notamment dans le domaine de la santé hospitalière. De plus, le refus de la réforme des retraites actuellement en chantier suscite des rapprochements nouveaux pour des syndicats comme la CGT, FO et la CGC qui dépassent la division privé-public et la limitation aux personnels d’« exécution » (ouvriers-employés). Dans le même ordre d’idées, l’épidémie actuelle met en exergue des pénuries de tests de dépistage, de masques et de gels hydroalcooliques qui renvoient à la destruction de capacités productives résultant de l’allongement des « chaînes de valeur » et à une externalisation de la recherche par les multinationales, comme Sanofi dans des start-ups.
Vous avez mentionné l’idée d’une sécurité sociale industrielle. Quelle serait-elle ?
Historiquement, je dirais que le droit du travail n’a pas été conçu comme la suppression du « droit de l’ouvrage », mais comme son dépassement. Un des enjeux a été de dépasser la sous-traitance en cascade pour rapporter les personnes s’inscrivant dans des « marchandages » distincts à un employeur général, en passant du marchandage — ou de la coopérative — à l’équipe où le chef d’équipe s’inscrit dans une organisation hiérarchique. Le droit du travail a ainsi ouvert l’horizon des travailleurs, au-delà de leur équipe, de leur atelier, sur l’établissement et l’entreprise. Aujourd’hui, le travail salarié sous la figure de l’emploi se heurte à la question de l’employeur. L’employeur est assimilable à une entreprise, se réduisant à une entité commerciale visant la compétitivité par une pression permanente sur l’emploi, tout en étant elle-même soumise à un processus de redéfinition juridique permanent par ses actionnaires. Il en résulte dans cette situation, que « gagner sa vie en travaillant, c’est à coup sûr la perdre en détruisant sa santé et la nature19 ». Mais cela n’invalide pas l’émancipation que porte en elle la capacité de « gagner sa vie » : émancipation des jeunes à l’égard de la tutelle familiale, émancipation des femmes à l’égard de la tutelle masculine (du bread male winner), etc. Pour Marx, le travail est un affrontement entre l’Homme et la nature, par lequel l’Homme découvre et développe les potentialités de sa propre nature. Face à une entreprise profondément instable — précaire ? —, j’ai évoqué une sécurité sociale industrielle donnant aux représentants du personnel les moyens de proposer des formes de développement sortant de la simple intensification du travail par suppression d’emploi requise par les entreprises financiarisées. Aujourd’hui, le point nodal me semble être la branche : pour les équipements comme pour les personnes, elle est l’espace privilégié pour contrecarrer le recentrage sur le « cœur de métier » qui caractérise les entreprises qui n’ont pas d’autre boussole que la création de valeur pour l’actionnaire20. Le niveau de la branche permet en effet un regroupement autour d’unités cohérentes et créatrices d’un point de vue économique et social.
Suite à la montée des contrats précaires est apparue la notion de « précariat ». Vous nuancez ce concept en rappelant que le CDI reste largement majoritaire dans les emplois occupés. Mais le précariat, n’est-ce pas aussi le fait que le CDI soit de moins en moins protecteur en lui même ? Pensons aux deux lois Travail, au plafonnement des indemnités de licenciement…
La notion de « précariat » a été forgée par le sociologue britannique Guy Standing en 2011 (sur le modèle du « prolétariat » : précaire/précariat ; prolétaire/prolétariat), pour suggérer l’émergence d’une nouvelle classe « dangereuse ». Elle a trouvé un écho important dans le monde anglosaxon, en fournissant un levier d’analyse pour des mouvements d’un style nouveau comme ceux qui ont visé la revalorisation des salaires dans les fast-food américains ou la syndicalisation au sein de Walmart, forteresse de l’antisyndicalisme mondial. Les analyses en termes de précariat me paraissent intéressantes pour penser des mobilisations touchant la jeunesse — la tranche d’âge la plus concernée par des emplois instables et le chômage —, ceci en rapport avec des perspectives altermondialistes, environnementales. Elles peuvent aussi expliquer une inhibition des capacités de mobilisation, par le besoin de « montrer patte blanche » si on veut conserver un emploi précaire. Plus généralement, il y a besoin de saisir les passages d’emplois à durée limitée à un emploi stable (norme commune du salariat aujourd’hui), en envisageant ce que deviennent les jeunes en vieillissant et en accédant à un emploi stable. Si les garanties des salariés ont été profondément affaiblies par les réformes récentes — présidences Hollande et Macron —, les effets de ces réformes sont peut-être moins à rechercher directement sur la stabilité, que sur la rémunération des emplois, dans la mesure où celles-ci limitent le pouvoir de négociation des salariés. Dans les enquêtes que je mène aujourd’hui auprès de représentants du personnel et de salariés, ce qui ressort est moins la « précarité » que le manque de reconnaissance, voire le mépris, à la fois en termes de salaire et de qualification. Cela se retrouve dans la question de « la fin du mois », posée par le mouvement récent des gilets jaunes.
Image de bannière : Peter Halley
- Art. 1710 du Code civil.↑
- Sur ce très important arrêt, Antoine Jeammaud, « Le statut des travailleurs de plateformes, une œuvre tripartite », Le Droit ouvrier, n° 861, avril 2020, pp. 181–214.↑
- Note de l’interviewé : Et dont le redressement de cinq millions contre Uber a été annulé pour vice de forme par la justice en mars 2017, en attendant un arrêt en appel qui tarde à venir…↑
- Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier, Droit du travail, Dalloz, 1990, p. 10–12.↑
- Art. 1780 du Code civil.↑
- Avec l’article 1781 du Code civil.↑
- Alain Cottereau, « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré, puis évincé par le droit du travail (France, XIXe siècle) », Annales — Histoire, Sciences sociales, 57–6, 2002, pp. 1521–1561.↑
- Alain Dewerpe, Le Monde du travail en France, 1850–1950, Paris, A. Colin, 1989.↑
- Gérard Noiriel, Les Ouvriers dans la société française (XIX-XXe siècles), Seuil, 1986.↑
- William H. Sewell, Gens de métier et révolutions — Langage du travail de l’Ancien Régime à 1848 (Aubier Montaigne 1983.↑
- Note de l’interviewé : Étendue aux activités agricoles en 1914.↑
- Camille Dupuy, Journalistes, des salariés comme les autres ? Représenter, participer, mobiliser, Presses Universitaires de Rennes, 2016.↑
- Karl Marx, Le Capital, Livre premier, PUF, 1993, [Éditions sociales, 1983], p. 620.↑
- Bernard Friot, Puissance du salariat, Paris, La Dispute, 2012 (1ère éd. 1998).↑
- Marnix Dressen, Jean-Luc Metzger et Bernard Friot, « Le salariat, classe révolutionnaire en puissance, entretien avec Bernard Friot », La Nouvelle Revue du Travail, 6/2015.↑
- Voir Antoine Jeammaud, « Les polyvalences du contrat de travail », Les Transformations du droit du travail — Études offertes à Gérard Lyon-Caen, Dalloz, 1989, p. 301.↑
- Voir Antoine Lyon-Caen, « Retrouver l’entreprise ? », Le Droit ouvrier n° 776, mars 2013, p. 196.↑
- « Aides aux entreprises : Bercy cible une baisse de 5 milliards d’euros », Les Échos, 23/05/2028.↑
- Claude Didry, L’Institution du travail – Droit et salariat dans l’histoire, La Dispute, 2016.↑
- Blandine Segrestin et Stéphane Vernac, Gouvernement, participation et mission de l’entreprise, Hermann, 2019.↑
Publié le 10 avril 2020 dans Économie, Sociologie par Ballast
https://www.revue-ballast.fr/le-salariat-une-classe-revolutionnaire-entretien-avec-claude-didry/