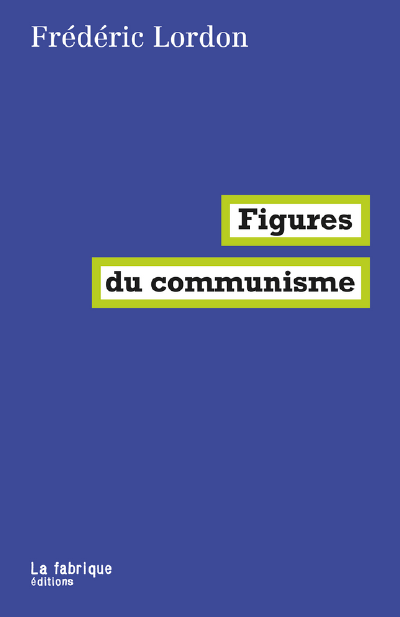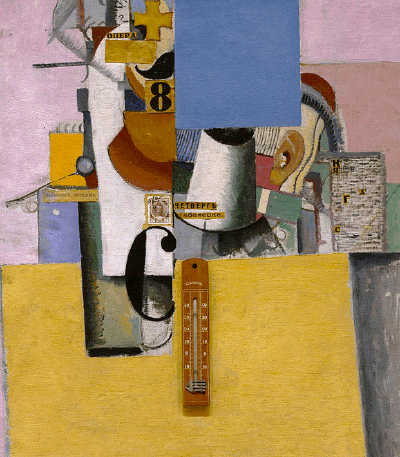Problèmes de la transition, Perspectives (IV)

Article paru sur le blog du monde diplomatique La pompe à phynance
-
Nicolas Hulot, passé à l’état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu’il réfléchit à un « green deal à la française ». Sur l’échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare des sommets — et les « jours heureux » nous sembleront comparativement un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent éveillés de « monnaie verte ». Benoît Hamon sort de son catafalque. On ne parlera plus bientôt que de « transition », comme déjà l’Union européenne sous les avisés conseils de BlackRock. Comme avec « l’Europe sociale et démocratique », mais un niveau au-dessus, on essaye de nouveau d’estimer le temps que toutes ces imbécillités vont nous faire encore perdre.
La transition n’est pas une question « écologique » (pour « écologistes »). Il ne s’agit pas de transiter vers un « capitalisme-respectueux-de-l’environnement » — on appelle « quadrature du cercle » les projets de transition vers les cercles carrés, et ça n’a jamais très bien fonctionné. Il ne s’agit pas de sortir du capitalisme « pas encore vert ». Il s’agit de sortir du capitalisme tout court.
Une transition de cette nature se réfléchit alors autour de trois grandes questions, toutes liées à la division du travail : 1) ce qu’on en garde, et ce qu’on en jette — le plus possible : nous avons sur les bras une planète qui tourne tantôt à l’incendie tantôt à la boîte de Pétri géante. 2) Le fait que la division du travail, spécialement sous la contrainte du « à garder », nécessite d’interroger la solution des autonomies locales. 3) Les nouveaux rapports sociaux dans lesquels la couler — pour qu’elle ne soit plus une division du travail capitaliste — et, d’abord, les fausses solutions qui rôdent en cette matière.
La division du travail : en garder et en jeter
Deux choses doivent être claires : 1) ce dont nous sommes mis en demeure, c’est d’en finir avec le capitalisme ; 2) sortir du capitalisme, c’est perdre le « niveau de vie » du capitalisme. À un moment, il faut se rendre à un principe de conséquence. On ne pourra pas vouloir la fin du système qui nous promet le double désastre viral et environnemental, et la continuation de ses « bienfaits » matériels. C’est un lot : avec l’iPhone 15, la voiture Google et la 7G viendront inséparablement la caniculisation du monde et les pestes. Il faudra le dire, le répéter, jusqu’à ce que ces choses soient parfaitement claires dans la conscience commune.
Toute la question du communisme a donc pour préalable celle des renoncements matériels rationnellement consentis, et de leur ampleur. Ceci est un sujet éminemment politique. Dans le capitalisme, le périmètre des satisfactions matérielles est abandonné à la croissance spontanée, anarchique, de la division du travail sous la conduite aveugle et folle de la valeur d’échange. Dans le communisme, ce périmètre redevient une question de délibération collective. Avec quels objets voulons-nous vivre, desquels pouvons-nous nous passer, desquels non ? C’est à nous de décider — et ce sera, en effet, de la politique : car tout le monde ne sera pas d’accord. Comme toute décision politique, celle-ci sera imparfaite, majoritaire seulement (la politique ne connaît pas l’unanimité).
Encore pour l’être — majoritaire — requerra-t-elle un principe de prudence, c’est-à-dire de discernement. Partant de la situation présente, du degré d’aliénation marchande auquel le capitalisme nous a réduits, avec un très grand succès d’ailleurs, on ne peut pas prendre pour hypothèse le surgissement instantané de l’homme nouveau, ni envisager de lui faire faire tout de suite des bonds de géant en matière de renoncements matériels. Des déplacements oui, des bonds non. La vie à la ZAD : un bond de géant — à la portée de quelques-uns seulement. Dans cette mesure même admirable… et impropre à soutenir une hypothèse majoritaire, en tout cas pour l’heure.
Bien sûr, on ne saurait présenter une transition révolutionnaire comme un simple renoncement, là où en fait il s’agit plutôt d’une grande substitution : abandonner une chose mais pour en gagner une autre : à la place de la vie comme quantité (le parfaitement nommé « niveau de vie »), la vie comme qualité ; à la place des futurs colifichets perdus par anticipation (iPhone 15, etc.), la tranquillité matérielle pour tous, de vastes services collectifs gratuits, une nature restaurée et, peut-être par-dessus tout, du temps. Cependant la grande substitution restera un fantasme sans suite si elle est trop exigeante, si le rapport des contreparties est trop défavorable relativement à ce que l’homme-pas-nouveau peut tolérer.
Par exemple, parmi les ennemis mortels de tout processus révolutionnaire, il y a les étals vides, et son corrélat : le marché noir inflationniste. Une transition révolutionnaire qui se retrouve face à ça est cuite. C’est dire qu’il y a intérêt à l’avoir pensé avant. La collectivité doit s’organiser pour déterminer l’ensemble des biens sur lesquels une tranquillité absolue doit régner pour tous : alimentation de qualité, logement de qualité — évidemment encore à conquérir, mais qu’au moins il n’y ait aucun recul — énergie, eau, moyens de communications, médecine et pharmacie, et « quelques autres choses encore » (Marx et Engels). Le renoncement et la substitution ne commencent qu’à partir de ce socle.
Héritant du niveau de développement des forces productives du capitalisme, nous avons des chances raisonnables d’y parvenir — c’est tant mieux. Les révolutions antérieures n’avaient pas eu cet avantage, et elles l’ont cruellement payé. On connaît le paradoxe de la révolution russe, survenue dans le pays où Marx la jugeait la moins probable du fait, précisément, de son arriération matérielle. Le paradoxe ne cessa pas d’être mordant puisque, la prise révolutionnaire du pouvoir accomplie, l’effort de développement eut à s’effectuer dans les pires conditions, toutes les ressources devant être dirigées vers le rattrapage des forces productives à marche forcée, le primat de l’industrialisation et des biens d’équipements — les moyens de produire tout le reste, notamment les biens de consommation, mais qui viennent logiquement avant eux. Et de même la Chine de Mao et son Grand Bond en avant, dont on sait dans quel état il a laissé la population chinoise. Drames du décollage économique forcé dans des rythmes infernaux, drames d’ailleurs pas seulement économiques : drames humanitaires, puisque ces transitions se sont payées de terribles famines, et drames politiques car seule la poigne de fer des régimes a « tenu » les populations à la grande transition dans des conditions aussi difficiles.
Sauf à être soutenues par un désir commun très puissant, les trajectoires de sacrifice se payent au prix politique fort. Les frustrations matérielles vécues finissent toujours par s’exprimer comme tensions politiques, parfois très violentes, dont la réduction ne fait pas dans la dentelle — et l’expérience révolutionnaire chargée d’espérance de verser dans l’autoritarisme le plus désespérant. Ces trajectoires ne sont plus envisageables. Heureusement nous avons désormais les moyens de nous les épargner. Dans le bilan historique du capitalisme, il restera donc qu’il était sur le point de détruire l’humanité en l’homme, de rendre la planète inhabitable, mais aussi qu’il nous laisse l’état de très haut développement de ses forces productives, et, partant, nous permet d’envisager de l’abandonner dans des conditions matérielles plus favorables que jamais — merci, au revoir.
Il va cependant sans dire que, si c’est pour faire tourner les machines capitalistes comme les capitalistes mais sans eux, ça n’est pas exactement la peine de se lancer dans des chambardements pareils. C’est donc la délibération politique qui détermine ce qu’il y a à garder de la division du travail capitaliste et ce qu’il y a à jeter. Qu’il faille en jeter un maximum, la chose est certaine. Mais qu’il faille en garder — évidemment pour la couler dans de tout autres rapports sociaux — ne l’est pas moins. Alors il faut reprendre la question du local et du global, mais cette fois sous l’angle des « autonomies » — et pour y faire des distinctions.
Des « autonomies »
Ici il faut redire et la valeur essentielle et l’insuffisance matérielle des pratiques « locales » de l’autonomie — pour les raisons mêmes qui viennent d’être indiquées : elles ne peuvent à elles seules fournir le « socle matériel » à partir duquel seulement le gros de la population peut entrer dans la logique du renoncement et de la substitution — les paris « anthropologiques » aventureux, à grande échelle, sur les « conversions frugales » finissent mal en général (soit en cruelles désillusions soit en autoritarismes politiques).
Mais il y a plusieurs manières d’envisager l’autonomie : l’autonomie purement « localiste », ou bien réinscrite dans un ordre social global. Purement « localiste », soit elle demeure partielle — autonomie centrée sur une pratique particulière (jardin, garage, dispensaire, etc.), et par-là reste branchée sur l’extérieur du système tel qu’il est ; soit elle va aussi loin que possible dans la reconstitution d’une forme de vie complète mais alors ne concerne que des participants « d’élite ».
Chacune à sa manière, les deux courent le même risque : celui de se détourner de fait de la transformation du système d’ensemble. Souvent d’ailleurs les pratiques de l’autonomie naissent au cœur d’une crise, comme des réponses réactionnelles à des situations de détresse matérielle. Ainsi, sans doute, par exemple, du mouvement très contemporain vers les jardins potagers dont la visée d’autosuffisance est manifeste… et suffit à dire son ambivalence : tourné vers la subsistance du petit collectif concerné, et de fait désintéressé du changement d’ensemble, soit : l’autonomie-expérimentation tournant en autonomie-fuite, sans égard pour ce qui reste derrière. C’est peu dire que le capitalisme s’en accommode fort bien. Il s’en accommode doublement même. D’abord parce que certaines de ces autonomies de nécessité sont réversibles : les participants retournent au système institutionnel standard dès que celui-ci refonctionne à peu près correctement — l’activité des clubs de troc et de monnaies parallèles en Argentine, par exemple, était très corrélée à la conjoncture globale, leurs membres revenant dès qu’ils le pouvaient au salariat comme solution privilégiée d’accès à l’argent.
Ensuite parce que, même quand ces expérimentations résistent au reflux et persévèrent, elles demeurent des isolats et le système d’ensemble n’en est pas affecté : au travers de la crise des années 2010, le capitalisme grec, au passage ravi que « ces gens aillent faire leurs affaires ailleurs, désencombrent les guichets de l’État-providence et nous épargnent des charges », n’en a pas moins continué son cours après qu’avant la floraison des lieux collectifs auto-organisés. Bien sûr, ce que le capitalisme grec ne voit pas, c’est que si ces expérimentations ne l’affectent pas dans le court terme, elles sont cependant des matrices à déplacements individuels, qui finissent par faire des déplacements collectifs, et lui préparent des situations difficiles quand ils viendront à maturité — c’est là l’éminente valeur de toute cette vie sous les radars des institutions officielles. Mais pour l’heure, c’est vrai, il a la paix. Les pratiques de l’« autonomie » forment donc un ensemble tout sauf homogène : « autonomies de détresse » réversibles, « autonomies de persévérance » locales et autocentrées, « autonomies locales mais de combat » branchées, elles, sur une perspective politique de propagation, selon un modèle de défection généralisée. À quoi il faudra ajouter une dernière sorte : « autonomies réinscrites dans une division du travail d’ensemble ». C’est à ces dernières qu’on verra ce que la transition ne doit pas être : de la « décroissance ».
Impasse de la décroissance
Car l’esprit humain va au bout du déni et des procédés dilatoires pour ne pas regarder en face ce qu’il lui est trop pénible d’envisager. Alors il continue de tirer jusqu’au bout du bout sur l’élastique pour faire durer encore un peu ce qui ne peut plus durer — en se racontant quand même qu’il est en train de « tout changer ». Typiquement : la décroissance. La décroissance est le projet insensé de n’avoir pas à renverser le capitalisme tout en espérant le convaincre de contredire son essence — qui est de croître, et indéfiniment. Au vrai, on peut très bien « décroître » en capitalisme. Mais ça s’appelle la récession, et ça n’est pas beau à voir.
De deux choses l’une donc : soit il est précisé que « décroissance » est un autre nom pour « sortie du capitalisme ». Mais alors pourquoi ne pas dire simplement… « sortie du capitalisme » ? Et surtout pourquoi maintenir cette problématique de la croissance (dont la décroissance n’est qu’une modalité) qui, en réalité, n’a de sens que dans le capitalisme. Il y a des questions qui appartiennent tellement à un cadre (ordre social) particulier qu’elles s’évaporent comme absurdités sitôt qu’on en sort. Par exemple, dans le cadre théologico-superstitieux, la survenue d’une pandémie peut donner lieu à des problèmes caractéristiques comme : « Qu’avons-nous fait qui ait pu offenser Dieu ? ». Alors le débat fait rage : « ceci l’a offensé, non c’est cela… ». Dans le cadre rationnel-scientifique, évidemment, ces questions-là n’ont pas trop lieu d’être — ont perdu tout sens. Les problèmes sont posés d’une façon tout à fait autre : la façon de la virologie, de l’épidémiologie, de l’économie politique, de la science des milieux naturels, etc. De même pour croissance et décroissance. Elles ne sont des obsessions cardinales que du monde capitaliste. Dans un monde communiste, on en est tellement libéré que ça ne traverse plus la tête de personne. Certes, le contrôle politique collectif de la division du travail ne cesse d’avoir à l’esprit (comme jamais d’ailleurs) les problèmes de l’inscription humaine dans la nature, et des dégâts qu’elle peut y commettre. Mais ces problèmes-là ne sont plus du tout codés dans les catégories de la « (dé-)croissance », qui n’ont de sens qu’attachées à l’ordre capitaliste. Si les mots ont une importance, pourquoi ceux qui entendent bien la « décroissance » comme sortie du capitalisme continuent-ils donc de couler leur discours dans les catégories du capitalisme ?
Soit, donc, la décroissance comme autre nom de la sortie du capitalisme, soit la décroissance comme autre chose dans le capitalisme — la version hélas la plus répandue. Qui se figure gentiment qu’un mode de production dont l’essence est la croissance pourrait se mettre à la décroissance-demain-j’arrête, et surtout qui a tout organisé selon la logique de la croissance : notamment l’emploi. Cas extrême, mais significatif : entre 2008 et 2014, la Grèce perd 33 % de PIB — une très belle performance de décroissance —, moyennant quoi son taux de chômage atteint 27 %. Oui, c’est l’ennui : dans le capitalisme, le rapport entre croissance et emploi est bien serré.
Hors de situations aussi critiques, ne pourrait-on cependant le dénouer un peu ? Par exemple envisager de maintenir l’emploi à taux de croissance moindre, voire négatif, en faisant porter l’ajustement sur la productivité — dont la baisse devrait être concomitante à celle de la croissance. Mais la baisse de la productivité, c’est celle du profit. Interrogeons les capitalistes :
— « Êtes-vous prêts à maintenir une masse salariale invariante en face d’un chiffre d’affaire diminué ? »
— « Mais certainement Madame Teresa, on commence demain ».
Un patron un peu roué aurait même la ressource de l’hypocrisie bien fondée, et de répondre que lui voudrait bien, mais ses actionnaires… Et de fait : s’il ne leur donne pas satisfaction, il sautera.
Pour rendre compatible maintien de l’emploi et décroissance capitaliste(s), il faudrait donc en finir avec le pouvoir actionnarial. Donc avec ses structures — celles de la déréglementation des marchés de capitaux. Tout ça commence à devenir très compliqué — en tout cas dans la logique qui voudrait bricoler une solution « à l’économie ». Et surtout très contradictoire. Car, dans l’alternative radicalisée désormais posée par l’état présent du capitalisme (et du capital), décidé à ne plus céder sur rien, soit l’épreuve de force tournera court, soit elle prendra l’ampleur d’un affrontement total où s’amorcera de fait un processus de rupture, pas seulement avec la « financiarisation », mais avec le capitalisme dans son ensemble. Mais alors, dans ces conditions, pourquoi ne pas y aller carrément ?
On aurait tort de se gêner car, en définitive, le petit problème « d’emploi » de la décroissance en capitalisme vient indiquer qu’il est en réalité celui du capitalisme. C’est le capitalisme qui a fait de l’emploi un problème — plus exactement notre problème, le problème des non-capitalistes —, tout de même que les curés avaient fait du courroux divin le problème des croyants sur lesquels ils régnaient. Et comme ceux-ci étaient pris en otages par le salut éternel, ceux-là sont pris en otages (d’une manière un peu plus rudement objective) par l’emploi. Et la société entière, sous l’ultimatum, se voit enrôlée dans les indifférences de la valeur d’échange, donc possiblement à faire tout et n’importe quoi : des pneus, du nucléaire, du gaz de schiste. Tout, dans le capitalisme, trouve sa justification par l’emploi. L’emploi est la solution imposée aux individus par le capital pour simplement survivre. Quand on a coulé les données de la survie des individus dans la forme de la valeur d’échange, tout le reste s’en suit sans coup férir. Un journaliste de France Info en décembre 2019 interviewe, pour le contredire, un opposant à la réouverture de Lubrizol : « mais quand même c’est bon pour l’emploi ». Le pire étant qu’il n’y a objectivement pas grand-chose à opposer à ça — sinon bien sûr qu’il faut urgemment se débarrasser du système qui fait régner ce genre de logique.
Car, comme toujours, le partage du « possible » et de l’« impossible » est conditionnel à l’acceptation implicite, et le plus souvent impensée, d’un certain cadre. Pour que du possible ré-advienne, il faut briser le cadre qui condamnait — objectivement — à l’impossible. Dans leur cadre, les capitalistes et les néolibéraux ont objectivement raison. Mais dans leur cadre seulement. De sorte qu’ils n’ont pas absolument raison. Ce que révèle, même, la pandémie, c’est que leur cadre est inclus dans un cadre plus grand — où se déterminent des enjeux, ceux de la planète et de la situation des hommes sur la planète, qui leur donnent absolument tort.
Nous commençons alors à mieux voir ce que nous avons à faire, et selon quelles lignes nous orienter : nous libérer simultanément des tyrannies de la valeur capitaliste et de l’emploi. Donc en détruire les institutions caractéristiques : la finance, le droit de propriété privé des moyens de production, le marché du travail.
À suivre
Frédéric Lordon